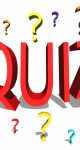Introduction
Aujourd’hui, pour le sens commun, l’expression « entreprise politique » apparaît comme un oxymore. En effet, les différents sondages réalisés auprès de la population révèlent que les Français estiment généralement que l’entreprise s’inscrit dans la sphère des intérêts privés que l’on peut opposer à la sphère du bien commun, incarnée par l’action de la puissance publique. Cette représentation commune de l’entreprise est parfois corroborée par la science. Pour un certain nombre de définitions académiques, le registre politique de l’entreprise signifie la politique générale de celle-ci, qui s’inscrit avant tout dans sa « vie interne » : politique commerciale, politique économique, politique financière, politique de recherche et de développement, politique de production et d’approvisionnement, ….
Cette vision de l’entreprise est cependant d’apparition récente. A la fin du XIXème, le paradigme de l’entreprise amène à la concevoir comme une organisation bénéfique pour la collectivité, qui associe travailleurs, ingénieurs et actionnaires au service d’une œuvre commune. Et dans ce paradigme le rôle de l’actionnaire n’est certainement pas le rôle essentiel. En 1916, Henri Fayol (Traité d’administration industrielle et générale) réduisait la fonction de l’actionnaire à peu de choses : la nomination des directeurs. Et ce n’est qu’à partir des années 1980 que l’on a vu s’affirmer le capitalisme financier, avec l’idée que les propriétaires de l’entreprise, donc les actionnaires, sont avant tout soucieux du cours des actions et de l’attribution de dividendes, bref d’une rentabilité financière qui l’emporte sur toute autre considération.
Dans ces conditions, le concept de l’entreprise politique n’est pas récent, à tel point que l’on peut parler d’une véritable « renaissance ». Il ne fait que renouer avec la conception dominante de l’entreprise, à la fin du XIXème siècle et pendant une grande partie du XXème siècle, au moment où celle-ci a apporté une contribution décisive à la transformation des modes de vie des populations des pays développés, en accompagnant la révolution des transports, la révolution énergétique, et l’apparition progressive d’une société de consommation de masse dans laquelle la consommation de « biens durables » tient une place essentielle.
Sur ce sujet de l’entreprise politique, la MAIF, née il y a maintenant presque 90 ans d’une volonté de rupture avec les pratiques en vigueur sur le marché de l’assurance, et qui est devenue un grand groupe français assurant plus de 3 millions de ménages ainsi que le premier assureur du monde associatif, a beaucoup de choses à nous apprendre. Dès son origine, la MAIF a incarné un modèle de développement original fondé sur la responsabilité, la transparence et la satisfaction de ses sociétaires, ainsi que sur des valeurs humanistes. Son histoire récente montre qu’elle est en train d’accélérer depuis maintenant une dizaine d’années la mise en œuvre d’un nouveau modèle d’entreprise qui fait de son engagement une source majeure de performance. En contrepoint de ceux qui opposent les sphères privée et publique, la MAIF crée un cercle vertueux dans lequel l’engagement pour les parties prenantes crée plus de performance pour l’entreprise, qui génère encore plus d’engagement.
I- LA RENAISSANCE DE L’ENTREPRISE POLITIQUE DANS LE DEBAT PUBLIC
A- Retour historique sur le paradigme de l’entreprise
Tout au long du XIXème siècle, les entreprises sont encore majoritairement des sociétés de personnes, c’est-à-dire des sociétés dans lesquelles le patrimoine de l’entreprise se confond avec celui de son (ou de ses) propriétaire(s). Dans l’immense majorité des cas, l’entrepreneur est un commerçant, et à ce titre, il porte toujours la responsabilité illimitée des dettes, et il en répond sur ses biens personnels. L’entreprise est une affaire privée et l’entrepreneur est le seul à porter le risque de l’activité entrepreneuriale. Cette figure du capitalisme porte le nom de capitalisme familial. Cela a pour conséquence qu’étant à la tête de l’entreprise, le patron a le devoir d’agir, non pas pour son intérêt personnel, mais pour assurer la continuité de sa famille, la pérennité de l’entreprise, et également l’emploi des salariés dont il est responsable. D’ailleurs, les grandes entreprises de l’époque portent des noms de famille : Krupp, Wendel, Rockefeller, …. Cela a une autre conséquence qui est que le dirigeant doit maintenir l’indépendance de l’organisation. La famille doit rester « maîtresse chez elle », ce qui suppose qu’elle gère la croissance avec un actionnariat relativement fermé et contrôlé. Dans ces conditions, la croissance de ce capitalisme familial est limitée, puisque le développement ne se fait pas essentiellement avec le marché financier, mais avec l’autofinancement dans toute la mesure du possible, et également le recours aux jeux d’alliance avec des « familles amies ». Et d’ailleurs, encore en 1867, au moment de la création des personnes morales de droit privé que sont les sociétés anonymes, le rôle de l’actionnaire n’est pas vraiment mis en relief. La meilleure preuve en est qu’à l’époque, la puissance publique n’est guère favorable à l’apparition de personnes morales de droit privé, à côté de personnes morales de droit public, qui selon elle sont les seuls garants de l’intérêt général (voir Jean-Philippe Robé, Le temps du monde de l’entreprise, Dalloz, 2016). En effet, préalablement, dans un avis rendu en 1825, le Conseil d’Etat posait très clairement que le gouvernement devait réserver le privilège de la société anonyme aux sociétés ayant pour objet la création d’établissements d’utilité publique.
L’« entreprise moderne » apparaît à la fin du XIXème siècle, et on peut la caractériser avec Blanche Segrestin et Armand Hatchuel (Refonder l’entreprise, 2012), par trois éléments fondamentaux. Le premier élément est le rôle nouveau que joue l’innovation. Entre 1880 et 1910, l’objectif de l’entreprise n’est plus seulement d’accumuler du profit, ou de gérer le patrimoine de ses associés, mais d’organiser collectivement une activité inventive, en mobilisant à cette fin une démarche scientifique. Ce qui compte, ce n’est plus l’accumulation du capital que décrivait Marx un peu plus tôt mais de détenir des brevets, de déployer de nouvelles méthodes de travail, de détenir des savoir-faire et de former ses employés. Les deux autres éléments ne sont que la conséquence de la place qu’a l’innovation dans l’entreprise moderne. Tout d’abord, on assiste à l’apparition du contrat de travail, au terme duquel le salarié n’est plus un être « misérable et méprisé », mais un individu engagé dans un espace de travail collectif organisé, qui est un espace de coopération, d’organisation rationnelle des activités, et aussi de transformation des individus. Ensuite, une nouvelle forme de gouvernance apparaît : la gouvernance managériale (d’où le nom de « capitalisme managérial » pour caractériser cette forme de capitalisme) dans laquelle les actionnaires, ou plutôt les propriétaires comme on l’a vu plus haut, qui étaient dans les sociétés commerciales du XIXème siècle des associés et même des administrateurs, deviennent simplement des « apporteurs de capital », et non des membres du collectif de l’entreprise. Ce sont désormais des hommes de terrain, à savoir le plus souvent des ingénieurs compétents, qui se consacrent pleinement à l’entreprise, qui vont gouverner le destin de celle-ci. Et l’objectif du manager est de tout faire pour mettre en œuvre des stratégies collectives innovantes et créatrices de richesse, ce qui a pu faire dire (à tort) à certains auteurs que l’objectif de croissance l’emportait alors sur l’objectif de profit. Bref, au début du XXème siècle et jusque dans les années 1970 à peu près, l’entreprise moderne est au service de l’intérêt général : c’est un collectif de travail tourné vers l’innovation, et donc l’amélioration de la vie en société grâce à la création de nouveaux produits et de services, et aux gains de productivité réalisés dans les nouvelles organisations productives.
B- L’émergence et la domination de la gouvernance actionnariale
La réorientation de l’épargne des ménages vers le capital des entreprises est sans doute le fait majeur de l’évolution du capitalisme depuis les années 1970. Cette réorientation, appelée aussi « massification de l’actionnariat », s’est traduite par une forte augmentation de la capitalisation boursière, passée de 30 milliards de dollars en 1970 à 34000 milliards en 2006, puis à un peu plus de 100000 milliards en 2020. Elle ne signifie pas pour autant que les millions de ménages concernés se soient sentis actionnaires des entreprises dont ils détiennent les parts. En réalité, toute une industrie de la finance, composée de fonds (de retraite, d’investissements, souverains, …), s’est interposée entre les épargnants et les entreprises, alimentant l’essentiel de ce que l’on appelle le « marché financier ». Cette évolution peut par exemple se mesurer à travers le poids des fonds de pension, qui sont aujourd’hui détenteurs de la majorité des actions cotées : 50% aux Etats-Unis, 70% en Angleterre, et même en France où à peu près la moitié des entreprises du CAC 40 sont détenues par des gestionnaires d’actifs. Dans ces conditions, il ne faut pas s’étonner que la responsabilité sociale des entreprises soit limitée à dégager suffisamment de bénéfices pour rémunérer l’épargne à un niveau convenable.
C’est dans ce contexte qu’est apparue la théorie de la gouvernance actionnariale et financière qui s’est imposée progressivement comme cadre normatif du gouvernement et du management des entreprises. D’après cette théorie, les actionnaires sont les meilleurs garants de la bonne gestion des entreprises parce qu’ils imposent des retours sur leurs investissements qui obligent les dirigeants à optimiser les outils de production. Dans cette logique, la production est ordonnée à la performance financière qui est estimée par rapport à celle des autres entreprises, évaluées universellement grâce à un même langage financier normalisé. Ce modèle anglo-saxon de l’entreprise a été théorisé par l’approche de Milton Friedman dans les années 1970, dans laquelle l’entreprise n’a pas d’autre visée que de faire du profit dans l’intérêt de ses actionnaires.
La vraie question est cependant de savoir si les dirigeants de l’entreprise sont capables « d’optimiser l’outil de production » dans le cadre d’un capitalisme actionnarial. Dès 1991, dans Capitalisme contre capitalisme, Michel Albert opposait le capitalisme rhénan et le capitalisme anglo-saxon. Dans sa typologie, le capitalisme rhénan se caractérise par une stabilité de la propriété des entreprises, souvent détenues par les familles fondatrices, et par une place limitée des marchés financiers dans leur financement. Dans ce capitalisme, les entreprises sont dirigées dans une optique de développement de long terme et sur la base d’un partenariat assumé entre les « parties prenantes » : salariés, clients, fournisseurs, … A l’opposé, le capitalisme anglo-saxon, qui a tendance à se généraliser du fait de la globalisation financière évoquée plus haut, est marqué par une prépondérance de l’actionnariat boursier, qui se traduit par une gestion de l’entreprise orientée vers sa profitabilité à court terme.
Et de fait, il semble bien que les marchés financiers soient devenus tout-puissants à partir des années 1980 et 1990, imposant une « dictature du court-terme », dans laquelle les profits distribués aux actionnaires (les dividendes) deviennent plus importants que les profits réinvestis dans l’entreprise. On a pu constater en effet à la fois que le montant des dividendes versés n’a pas cessé d’augmenter depuis 40 ans, et en même temps que la durée moyenne de détention des actions est passée de 5ans dans les années 1980 à 5 mois dans les années 2000. Une telle évolution menace le capitalisme et la croissance mondiale. La raison en est que le capitalisme se définit par la durée, durée qui correspond bien souvent au cycle de l’innovation sur plusieurs décennies. Au moment de l’essor du capitalisme, des auteurs aussi différents que Marx et Weber ont souligné le rôle de l’accumulation du capital dans la genèse de ce mode de production. On se rappelle la célèbre formule de Marx : « Accumulez, accumulez, c’est la loi et les prophètes ». Quant à Weber, il a pu mettre en relief dans son œuvre le rôle décisif de l’éthique protestante, et donc de la frugalité et de l’épargne qui y sont liées, dans l’émergence de l’esprit du capitalisme. Même si le capitalisme a connu des mutations importantes depuis son apparition, on peut tout de même raisonnablement considérer que la tendance actuelle à l’enrichissement de court terme vient à rebours de plusieurs siècles d’investissement dans le long terme, et donc de l’essence de ce mode de production.
C- La mise en question de la gouvernance actionnariale
Au moment de son apparition, la gouvernance actionnariale fait déjà question. Dès les années 1960, le débat sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE) connaît un véritable essor aux Etats-Unis, avec le concept précurseur attribué à H.R Bowen (Social Responsability of Businessman, 1953), qui met l’accent sur la bienfaisance comme corollaire du principe de responsabilité de l’entrepreneur, en privilégiant les relations contractuelles et non l’action de la puissance publique en la matière, conformément à la tradition anglo-saxonne. Ce débat prend de l’ampleur à partir des années 1970, du fait des mouvements divers de la société civile, dans un contexte de mondialisation croissante des activités économiques. C’est dans ce cadre que J. Eklington (Cannibal with Forks. The Triple Bottom Line of 21st Century Business, Capstone Publishing Limited, Oxford, 1994) a popularisé la notion de triple bottom line (people, planet, profit) pour exprimer l’idée que l’entreprise ne s’apprécie pas seulement sur des critères économiques, ce qui ouvre la voie à un véritable « marché de vertu » destiné à redonner une légitimité morale aux grandes entreprises. C’est aussi à cette époque que se structure l’opposition entre les modèles « shareholdering » et « stakeholdering » de l’entreprise. Pour M. Friedman et le courant libéral de l’école de Chicago, la responsabilité sociale de l’entreprise ne s’exerce que par les seules décisions destinées à améliorer la rentabilité pour les actionnaires : l’entreprise n’est responsable que devant ses « shareholders ». En revanche, pour E.R Freeman (A stakeholder Theory of the Modern Corporation, 1984), la responsabilité de l’entreprise s’étend à tous les acteurs ayant un intérêt dans celle-ci. La théorie des « stakeholders » (parties prenantes en français, « primaires » comme les actionnaires, dirigeants, salariés, ou plus ou moins « secondaires » comme les fournisseurs, les clients, les interlocuteurs administratifs, etc..) remet en cause la primauté des actionnaires dans la gouvernance de l’entreprise. Dans cette théorie, l’entreprise est insérée dans un ensemble avec des partenaires qui ne sont plus des adversaires, mais des acteurs intéressés par les activités et décisions de celle-ci.
En Europe, la RSE s’est développée dans les années 1970 pour justifier certaines réformes, et notamment celle du bilan social, que l’on peut définir comme une réflexion sur l’apparition d’instruments de dialogue avec les parties prenantes, contribuant au renforcement des possibilités de contrôle, non seulement des « shareholders », mais aussi des « stakeholders ». En pratique, la mise en œuvre d’une RSE consiste à produire un progrès continu dans les domaines du social, de l’environnement, et bien sûr aussi de l’économique. Il s’agit alors de prendre en compte l’environnement de l’entreprise pour intégrer la qualité des filières d’approvisionnement et de la sous-traitance, l’empreinte écologique de l’unité de production, le bien-être des salariés….
Toutefois, en dépit de ces bonnes intentions, la RSE étant souvent perçue comme un élément cosmétique, une mesure correctrice d’une organisation qui demeurait pour l’essentiel assujettie à ses actionnaires, toute une réflexion s’est développée pour définir les contours d’une « entreprise post-RSE (voir Félix Torres, L’entreprise post-RSE, Institut de l’Entreprise, 2018), qui n’ajoute pas seulement la RSE comme un additif marginal à ses préoccupations stratégiques, mais qui en fait au contraire le cœur de son action. C’est alors la notion de performance globale de l’entreprise qui est mise en relief, avec l’idée que l’entreprise doit désormais viser, non une simple recherche de profit, mais la création d’une « valeur partagée ». En appréhendant d’une manière compatible avec les équilibres sociaux et environnementaux ses produits et ses marchés, en redéfinissant ses chaînes de valeur, l’entreprise accroît sa performance tout en gagnant en légitimité (comme le montre bien l’exemple de la MAIF ; voir plus bas).
En Europe, ou le bien commun est conçu comme une construction politique (alors que dans le monde anglo-saxon, il est plutôt vécu comme le fruit de l’agrégation de décisions individuelles), c’est bien souvent par la loi que les rapports sociaux évoluent. Si on se limite au cas français, on peut considérer que c’est la loi du 02 août 2016 (dite loi travail) qui a réalisé une véritable substantialisation de la RSE en passant d’une simple obligation d’information du droit des parties prenantes, et tout particulièrement du droit des salariés, à une obligation sanctionnée, en s’appuyant sur le cas des plateformes numériques, loi bientôt suivie de la loi du 09 décembre 2016 (qui reconnaît de manière uniforme le droit d’alerte professionnelle) et de la loi du 27 mars 2017 (qui crée le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneurs d’ordre). Mais l’étape décisive est la loi PACTE, promulguée le 16 mars 2019 à la suite du rapport Notat-Senard (« L’entreprise, objet d’intérêt collectif ») qui était destiné à formuler des propositions pour mieux intégrer les objectifs sociaux et environnementaux dans les stratégies d’entreprise. La loi PACTE définit en effet « l’entreprise à mission » comme une société commerciale qui se définit statutairement, en plus de son but lucratif, une finalité d’ordre social et/ou environnemental. La société de mission repose sur trois étapes. La première étape, qui s’adresse à toutes les sociétés, est une modification du Code civil qui affirme la nécessité que « toute Société prenne désormais en compte les enjeux sociaux et environnementaux liés à son environnement », au-delà de la simple cause lucrative mentionnée à l’article 1832 du Code. Tout dirigeant est maintenant amené à s’interroger sur ces enjeux à l’occasion de ses décisions de gestion. La deuxième étape, qui est une étape facultative, est la « raison d’être », définie comme « un projet entrepreneurial répondant à un intérêt collectif et qui donne sens à l’action de l’ensemble des collaborateurs », compatible avec l’objet social de l’entreprise, qui s’inscrit dans ce « projet de long terme ». La troisième étape, facultative elle aussi, est la société de mission qui vient coiffer ce dispositif, permettant aux sociétés qui se sont données une raison d’être d’aller encore plus loin en se dotant d’objectifs sociaux et environnementaux, qui font évidemment l’objet d’une évaluation programmée dans le temps.
II- LE CHEMINEMENT DE LA MAIF VERS L’ENTREPRISE POLITIQUE
A- Une longue histoire
L’origine de la MAIF la prédispose particulièrement à réaliser assez facilement le passage à l’entreprise « au cœur de la cité » qui est le fondement de l’entreprise politique.
La MAIF est née en 1934, en pleine crise économique, à une époque où le monde de l’assurance semblait aux instituteurs plus soucieux des profits réalisés que des garanties offertes aux assurés. L’idée était alors de faire vivre une mutuelle, c’est-à-dire une association de personnes qui, ayant à la fois la qualité d’assureur et celle d’assuré, se regroupent dans le but de se protéger réciproquement contre les aléas de la vie. C’est cette volonté collective qui est à l’origine de la création d’une mutuelle complètement indépendante dans le secteur de l’assurance automobile, la Mutuelle d’assurance automobile des instituteurs de France (MAAIF). Conformément à la tradition humaniste qui accompagne l’esprit mutualiste, la vocation première de la MAIF, qui sera toujours réaffirmée par la suite, c’est le service de l’Homme et non la recherche du profit. Quant au mutualiste, il n’est pas un simple consommateur d’un service produit par une entreprise. C’est un acteur conscient et responsable de son rôle dans une organisation collective conçue pour répondre à ses aspirations profondes.
L’esprit mutualiste sera maintenu dans l’après-guerre avec la croissance de l’entreprise, la qualité des garanties offertes et les tarifs pratiqués attirant en nombre de nouveaux sociétaires. Le succès de la MAIF est tel que sa réussite inspire d’autres mutuelles, dont elle soutient la création : la MAAF (1950), la MACIF (1960), la MATMUT (1961). Ensuite, au fil des années, la MAAIF élargit son champ d’intervention au-delà de l’assurance automobile : symbole de cette évolution, son sigle perd son A de « automobile » et devient MAIF.
A partir des années 1980, la MAIF diversifie ses activités vers l’assurance-vie et la prévention, notamment avec la création de Parnasse vie en 1985 (aujourd’hui MAIF vie). En même temps, elle s’ouvre à de nouveaux publics en 1988 avec la création de sa filiale (Filia-MAIF) où elle crée la possibilité d’adhérer pour tous ceux qui partagent les valeurs du groupe MAIF, ce qui permet d’assurer aussi bien les enfants des sociétaires que les sociétaires qui changent de métier. Cette stratégie de déploiement sans renier ses valeurs fondatrices se poursuit jusqu’à nos jours, avec la récente ouverture de ses statuts aux entreprises en 2021.
Mais en tout cas, tout au long de l’histoire de cette croissance et de cette diversification, la MAIF a maintenu une gouvernance originale, qui s’appuie sur un réseau de militants et un maillage serré de délégations départementales, qui s’efforcent d’offrir à leurs sociétaires des services adaptés à leurs besoins. La gouvernance de la MAIF demeure en effet totalement démocratique au fil du temps, s’appuyant sur 3,2 millions de sociétaires qui élisent parmi eux 750 délégués à l’Assemblée générale, représentants qui élisent à leur tour les membres du Conseil d’administration. Et ce fonctionnement garantit que le président élu par le Conseil d’administration soit avant tout un sociétaire (Dominique Mahé depuis mai 2014), avec à ses côtés un Directeur général (Pascal Demurger aujourd’hui, et depuis 2009) qui propose et met en œuvre la stratégie de l’entreprise.
B- L’intégration progressive des objectifs sociaux et environnementaux
L’entreprise politique qu’est désormais la MAIF a pour finalité, conformément à son histoire, de mettre l’économie au service de l’Homme et de promouvoir un capitalisme plus inclusif. Cette exigence passe par l’intégration des objectifs du développement durable et par la promotion d’un nouveau modèle de management.
L’intégration des objectifs durables à la MAIF commence par des actes à la fois simples et importants du point de vue de l’exemplarité. C’est ainsi que l’entreprise n’a pas de plateaux téléphoniques au Maroc ou de gestionnaires de sinistres à Madagascar, pas plus que de développeurs informatiques en Inde permettant de réaliser des économies sur les frais généraux. Domiciliée en France, la MAIF part du principe qu’elle y paie la totalité de ses impôts, assumant par-là pleinement ses responsabilités de contribuable : un principe qui, faut-il le rappeler, n’est guère partagé par de nombreuses multinationales. De même, la MAIF cherche à réduire sa consommation d’énergie par de nombreuses initiatives : l’énergie consommée y est produite à partir de sources renouvelables, les salariés sont invités autant que possible à éviter le recours à l’automobile pour les trajets domicile-travail, le papier utilisé est issu du recyclage ou de forêts gérées en sorte de préserver la diversité biologique, la production de déchets est réduite au strict minimum.
Mais l’urgence climatique exige des entreprises un engagement qui va au-delà des gestes du quotidien. Comme le dit Pascal Demurger, directeur général de la MAIF (L’entreprise du XXIème siècle sera politique ou ne sera plus, Editions de l’Aube, 2019), c’est le cœur de l’entreprise qu’il faut désormais transformer.
Concrètement, cela signifie la mise en place d’une véritable économie circulaire de la pièce détachée automobile (en tant qu’assureur, la MAIF prend en charge chaque année 300000 véhicules accidentés, ce qui lui donne une forte capacité de prescription en matière de réparation automobile). La structuration d’une filière de recyclage des pièces détachées n’est pas forcément rentable pour l’assureur puisque la déconstruction des épaves en France coûte actuellement plus cher que leur envoi vers les pays en développement. Mais elle permet à la fois de réduire l’empreinte écologique de la réparation en limitant la production de composants neufs et en repoussant les limites écologiques de la réparabilité des véhicules, et également d’envisager à terme une baisse du coût des réparations pour les propriétaires de voitures.
Cela signifie également une autre philosophie de la collecte de l’épargne et de la gestion d’actifs financiers. La MAIF a été pionnière de la prise en considération des critères ESG (Environnementaux, Sociaux, et de Gouvernance), et elle réalise dès aujourd’hui plus de 88% de ses placements sur la base de ces critères, bien au-dessus des critères du marché. Elle a ainsi soutenu de nombreux projets originaux, à l’image du fonds MAIF Transition lancé en 2019. Ce fonds, destiné à financer les transitions énergétique et agricole, vise à concilier l’installation d’unités de production photovoltaïques au sol avec l’insuffisance de terrains disponibles. Il s’agit de financer des projets combinant installations photovoltaïques et conversion à l’agriculture biologique sur un même terrain, pour rendre les deux transitions possibles. Dès 2019, 50 millions d’euros ont été mobilisés pour financer des projets de ce type, avec l’ambition d’atteindre 400 millions d’euros à terme.
Enfin, les engagements de la MAIF en matière de développement durable portent aussi sur la gestion des données. En la matière, l’engagement est de ne pas revendre les données des sociétaires, d’héberger ces données dans l’Union européenne, de garantir la transparence sur le contenu de ces données et leur provenance (conformément aux obligations du Règlement général sur la protection des données), et d’ouvrir un droit à l’effacement des données. En ce qui concerne l’intelligence artificielle, alors que beaucoup d’entreprises perçoivent son arrivée comme une occasion de diminuer la masse salariale et d’améliorer la productivité, la MAIF pense que l’on peut dépasser la classique opposition entre l’homme et la machine en utilisant celle-ci, non comme une solution alternative à l’homme, mais comme un moyen d’améliorer la performance de chacun. L’engagement sur le digital concerne enfin le recours à l’open source, puisque la philosophie du logiciel libre est parfaitement en phase avec l’approche collaborative et contributive que promeut l’entreprise. Depuis maintenant plus de deux ans, la MAIF a mis à disposition de tous le code de plusieurs développements réalisés en interne (par exemple, un outil de gestion et de routage des emails). Cette démarche a d’ailleurs été récompensée en 2018 par le Conseil national du logiciel libre.
Depuis maintenant quelques années, la MAIF fait de la confiance l’axe central de sa manière d’être et de ses relations, à tel point qu’elle qualifie son style managerial de « management par la confiance », ce qui est très important de nos jours, dans une société où c’est plutôt la défiance qui s’impose comme le marqueur essentiel des relations sociales (Yann Algan et Pierre Cahuc, La Société de défiance, CEPREMAP, Editions rue d’Ulm, 2007). Le déploiement progressif de ce principe de management a créé quelques changements radicaux dans les comportements au sein de l’entreprise.
Toujours au niveau du management, la relation managériale à la MAIF s’inscrit dans sa tradition humaniste. Il ne s’agit plus seulement de commander, mais d’accorder sa confiance, de déléguer, d’offrir des marges de manœuvre réelles à chacun. Une des premières illustrations de ce principe concerne l’organisation du temps de travail. Grâce à une approche très différente du travail, non pas considéré comme une souffrance, mais comme un vecteur potentiel d’approfondissement de soi, et aussi à la mise en œuvre d’une méthode très participative, l’entreprise a pu faire converger les aspirations des salariés et les besoins de l’organisation. L’accord d’entreprise signé en 2018 a permis la mise en place d’une organisation du travail qui permet aux salariés de choisir librement leurs horaires en dehors des plages planifiées. En élargissant les amplitudes horaires et en annualisant le temps de travail pour mieux s’adapter aux cycles d’activité, les collaborateurs de l’entreprise peuvent désormais organiser beaucoup plus librement leur temps, adopter le télétravail et bénéficier d’un système de préretraite partiellement financé par l’entreprise. Une autre illustration est fournie par le système de rémunération. A la différence des systèmes qui valorisent la performance individuelle, le système de rémunération de la MAIF met en relief le collectif dans la reconnaissance de la performance de l’entreprise. L’intéressement est alors distribué, au sein d’un service ou d’une direction donnés, de manière totalement égalitaire. Ce système permet de valoriser une culture de la réussite collective plutôt que la mise en avant de l’individu. Dans le même ordre d’idées, la MAIF pense que la recherche de cohésion passe par le maintien d’un éventail de rémunérations à un niveau raisonnable. A la MAIF, l’écart de rémunération entre les salaires les plus bas, sensiblement supérieurs au SMIC, et les plus élevés, est maintenu dans un rapport de l’ordre de 1 à 20 (dans cette catégorie d’entreprises, la moyenne des salaires perçus par les dirigeants correspond à 187 fois le SMIC…).
Dès maintenant, ce principe de responsabilisation progressive des équipes a donné des résultats significatifs du triple point de vue de l’épanouissement des collaborateurs, de la qualité du dialogue social et de la performance de l’entreprise. L’épanouissement des collaborateurs s’appréhende surtout par leur enthousiasme qui se manifeste par la volonté de bien faire, un sens du service irréprochable, un taux d’absentéisme très faible, un niveau de participation record aux manifestations organisées par l’entreprise, ou encore une spontanéité à défendre la MAIF en toute occasion, ce sens du service se retraduisant dans des « baromètres consommateurs ». La qualité du dialogue social s’éprouve dans la relation avec les partenaires sociaux, qui sont extrêmement confiantes et constructives, puisque ceux-ci approuvent la stratégie de l’entreprise. Quant à la performance, elle est indéniable. Pour reprendre les propos de Pascal Demurger, l’entreprise est passée en quelques années de l’image « d’une mutuelle considérée par la profession comme la belle endormie du secteur à une entreprise aujourd’hui perçue comme l’une des plus innovantes ». La dynamique collective de l’entreprise s’exprime dans une qualité de service et une satisfaction hors norme des sociétaires. Pour Pascal Demurger, c’est d’ailleurs la qualité de la relation avec les sociétaires qui fonde le modèle de développement de la MAIF à long terme.
C- Être société à mission
Le statut de société à mission a été adopté par la MAIF en 2020. Être société à mission donne une nouvelle dimension aux différentes facettes de la responsabilité sociétale de l’entreprise qui a été initiée depuis une vingtaine d’années. Pour parvenir à la société de mission, conformément aux étapes de la loi PACTE, la MAIF s’est dotée d’une raison d’être en mai 2019. Et le 11 juillet 2020, les représentants de la MAIF, réunis en assemblée générale extraordinaire, ont validé la proposition du Conseil d’administration de faire de la MAIF une société à mission. Dans ce cadre nouveau, la MAIF se fixe 5 objectifs sociaux et environnementaux qui sont les suivants :
1- Placer l’intérêt de ses sociétaires au cœur de ses activités.
2- Favoriser, par une attention sincère, l’épanouissement de ses acteurs internes au sein d’un collectif engagé.
3- Contribuer à la construction d’une société plus solidaire à travers ses activités.
4- Contribuer à la transition écologique à travers ses activités.
5- Promouvoir le développement de modèles d’entreprise engagés dans la recherche d’impacts positifs.
Avec la raison d’être et l’inscription dans les statuts de l’entreprise des objectifs sociaux et environnementaux que l’on vient d’évoquer, la loi PACTE prévoit trois autres conditions pour créer une société à mission : se doter d’un comité de suivi (distinct des organes qui existent déjà dans les entreprises, comme le Conseil d’administration par exemple), faire en sorte que l’exécution des objectifs fasse l’objet d’une vérification par un organisme indépendant (audit externe), et enfin que les modifications statutaires évoquées plus haut soient inscrites au greffe du tribunal de commerce pour vérification pour les sociétés commerciales, cette dernière condition ne s’appliquant pas à la MAIF.
Pour respecter ces exigences de suivi et de contrôle rigoureux des objectifs poursuivis, la MAIF a mis en place une « gouvernance associée » qui repose sur un comité de mission et un contrôle d’impact.
Le comité de mission de la MAIF rassemble 10 membres : 5 représentants des parties prenantes (administrateurs et salariés), et 5 membres externes indépendants. Le rôle de ce comité est d’aider l’entreprise à progresser dans l’exécution de sa mission et, comme son nom est indiqué dans la loi, d’assurer le suivi de sa mise en œuvre. Pour cela, il procède aux vérifications qu’il juge opportunes, propose de nouvelles actions pour enrichir la mission, et rédige un rapport porté à la connaissance des représentants des sociétaires lors des Assemblées générales qui les réunissent chaque année. Quant au « contrôle externe », il est réalisé tous les deux ans par un organisme tiers indépendant (OTI) agréé par le Comité français d’accréditation. Cet OTI émet un avis motivé sur le respect des objectifs sociaux et environnementaux, en indiquant au besoin les raisons de la non-atteinte (ou de l’atteinte partielle) de l’un ou de plusieurs de ces objectifs. Cet avis externe est publié sur le site de la MAIF pendant 5ans, et joint au rapport rédigé par le comité de mission.
CONCLUSION
L’exemple de la MAIF nous montre qu’aujourd’hui la responsabilité sociale et environnementale ne suffit plus : le temps est venu d’assurer une véritable responsabilité politique de l’entreprise. Cette exigence s’applique à toutes les formes d’entreprise, et on peut même considérer avec Jean-Marc Borello (président-fondateur du groupe SOS, leader en France de l’économie sociale et solidaire) que la loi PACTE a contribué à développer les liens entre l’économie sociale et l’économie classique en montrant que les problématiques de l’entrepreneuriat sont bien souvent communes aux différents secteurs d’activité.
D’ailleurs, sur la loi PACTE, des PDG comme Antoine Frérot pour Veolia ou Emmanuel Faber pour Danone ont été de véritables pionniers. En ce qui concerne Danone, celle-ci est devenue la première société cotée à revêtir la nouvelle forme d’entreprise à mission introduite par la loi PACTE, et cette décision s’inscrit dans l’histoire de l’entreprise puisqu’on peut la faire remonter au discours d’Antoine Riboud prononcé en 1972 devant les patrons du CNPF de l’époque, au moment où celui-ci affirmait que l’entreprise avait un double devoir, économique et social, en même temps. Au niveau de Veolia, si l’entreprise a depuis sa naissance une responsabilité sociale par la nature même de son activité, cette responsabilité a pris un nouvel essor depuis 2018, avec le compte-rendu du Conseil d’administration. Ce compte-rendu exprime bien en effet les contours de la raison d’être de l’entreprise, qui ne se limitent pas à un recueil d’aspirations des parties prenantes, mais qui sont un acte d’ouverture à l’égard des écosystèmes et des territoires, un engagement entrepreneurial avec les parties constituantes et les parties prenantes, dans le cadre d’une gouvernance d’entreprise rénovée.
Evidemment, lorsqu’il s’agit d’entreprises privées, on peut se poser la question de savoir si l’intérêt des actionnaires est compatible avec les exigences de la raison d’être. D’une manière très concrète, les difficultés du PDG de Danone avec le fonds d’investissement Artisan Partners (qui détient 3% du capital de l’entreprise en 2020) qui questionne la nouvelle stratégie de l’entreprise sont très révélatrice de ces tensions.
Mais en réalité on ne peut qu’en apparence opposer l’intérêt des actionnaires avec celui des autres parties prenantes de l’entreprise. Avec Oliver Hart et Luigi Zingales (Harvard Business Review, n°10, octobre 2017), on peut considérer qu’il existe un « intérêt actionnarial élargi » (shareholder welfare) que l’entreprise devrait maximiser plutôt que la valeur actionnariale (shareholder value). Cet intérêt actionnarial élargi part du postulat que les préoccupations des actionnaires ne se réduisent pas à l’argent. En effet, les actionnaires, qui ne sont pas différents par nature des autres acteurs de la société civile, se préoccupent également de la préservation des équilibres environnementaux et sociaux. Pourquoi souhaiteraient-ils que les entreprises dans lesquelles ils investissent agissent différemment ? L’idée est qu’il n’y a aucune raison qu’un Conseil d’administration d’entreprise ne prenne pas en compte certains objectifs non financiers et poursuive exclusivement une logique d’accroissement des profits dans la perspective de la distribution de dividendes. On peut même considérer que l’obligation d’un Conseil d’administration vis-à-vis de ses actionnaires est de servir au maximum cet intérêt élargi, et non simplement d’accroître la valeur du portefeuille.
En tout cas, si on admet avec Pascal Demurger (L’entreprise du XXIème siècle sera politique ou ne sera pas, op.cit) que l’entreprise de l’avenir sera nécessairement politique, sous la pression des salariés, des consommateurs, et des épargnants pour faire évoluer les pratiques, ce nouveau modèle d’entreprise peut représenter une chance pour l’Europe face à la pression des capitalismes américain et chinois. Le continent européen, qui a su créer un modèle économique et social original fondé sur l’équilibre entre le capital et le travail, sur la protection sociale et les marchés régulés, peut maintenant se réinventer avec l’entreprise politique. Cela exige cependant une initiative politique d’envergure. Comme le dit Pascal Demurger, « l’urgence est désormais dans la prise de conscience d’un nouvel âge de l’entreprise ».
Voir la Vidéo
La MAIF ou la renaissance de l’entreprise politique (Judith Leverbe)
PARTIE PEDAGOGIQUE
2 - La question de la gouvernance, au cœur de l’entreprise politique
Document vidéo à écouter
Exercice de synthèse : qu’apporte la loi PACTE d’un point de vue juridique ?

Document vidéo à écouter
3 - Entreprise et dynamique sociétale : l’exemple de la MAIF
Document : la MAIF en chiffres

Questions :
A - Relever les éléments qui traduisent concrètement les choix sociétaux de la MAIF.
B - Relever quelques parties prenantes de la MAIF
Voir la correction
A- Relever les éléments qui traduisent concrètement les choix sociétaux de la MAIF.
La MAIF a une stratégie conforme à son engagement social à différents niveaux :
- d’une part, elle s’inscrit dans l’accompagnement d’entreprises qui font vivre le tissu économique local ;
- d’autre part, elle accompagne, par l’orientation de ses filiales de gestion de l’épargne, les jeunes entreprises innovantes, engagées, par surcroît, dans une démarche responsable sur le plan environnemental ou sociétal ;
- enfin, la MAIF est l’un des assureurs des secteurs associatif, coopératif et public.
B- Relever quelques parties prenantes de la MAIF
Elles sont évidemment nombreuses mais on identifie ici : les collectivités locales, les sociétaires, les créateurs d’entreprises dans l’économie sociale et solidaire, les associations et les salariés de la MAIF.
4 - Devenir Société à mission : le cas de la MAIF
Document : Interview du Président de la MAIF Dominique Mahé
Si nous voulons aller sur le terrain de la société à mission c'est qu'elle va nous permettre d'aller plus loin encore dans notre engagement pour le "mieux commun". De par notre statut juridique de mutuelle, qui permet aux sociétaires de s'assurer entre eux, nous avons un terrain, une histoire et une réalité très concrète dans ce domaine. La fidélisation des sociétaires prime sur la conquête avec un taux de départ volontaire des sociétaires inférieur à 1%. Nous avons (…) obtenu le ratio 99/100 à l'index Pénicaud (sur l'égalité femmes-hommes). Et 82% de nos placements relèvent de critères ISR (investissements socialement responsables). […]
La première étape consiste à définir la raison d'être de l'entreprise. Quelle est celle du groupe Maif et comment l'avez-vous choisie ?
L'expression de notre raison d'être est la suivante : « Convaincus que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun, nous la plaçons au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions ». Elle a fait l'objet de débats et de nombreuses reformulations mais nous pensons que la notion « d'attention sincère portée à l'autre » est ce qui caractérise le mieux le groupe Maif. Envers nos sociétaires, cela s'illustre par une écoute désintéressée - nos conseillers ne sont pas rémunérés à la commission - et par une écoute empathique - ces derniers ne suivent pas de script. […]
Quelles mesures allez-vous prendre pour que cet engagement dépasse la simple communication ?
Ce seront des engagements évaluables, sur le plan quantitatif et qualitatif, et opposables. Si nous ne les respectons pas, nous perdrons la qualité d'entreprise à mission. D'un point de vue de la gouvernance, nous allons mettre en place un comité de suivi de cette mission. C'est un comité des parties prenantes où nous retrouverons des sociétaires, des salariés et des partenaires. C'est extrêmement engageant, ce n'est pas de la cosmétique. […]
Comment aujourd'hui réaffirmez-vous votre engagement pour le bien commun ?
Nous nous engageons à accompagner la filière du recyclage automobile. Aujourd'hui, les constructeurs ont le monopole de la production et de la commercialisation des pièces automobiles. Nous subissons ainsi une inflation permanente de 3% à 4% sur le prix de ces pièces détachées. Nous pensons que si nous poussons les réseaux de déconstructeurs à procéder autant que possible aux recyclages des pièces (des véhicules hors d'usage des sociétaires) pour en faire des pièces de réparation cela aura un impact positif sur notre métier d'assureur puisque cela rejaillira sur les montants des primes. Cela aura aussi, bien sûr, un impact sur l'environnement en limitant la production de ces pièces.
Nous lançons également un nouveau fonds d'investissement, Maif Transition, qui sera doté au départ de 50 millions d'euros et dont le montant, je l'espère, pourra croître dans les années à venir. Ce fonds, développé en partenariat avec Akuo Energy, vise à conjuguer deux ambitions : contribuer au développement des énergies renouvelables et notamment solaires via l'installation de panneaux photovoltaïques sur des terres agricoles et permettre le renouveau des terres arrivées à succession. Grâce aux revenus générés par la vente d'électricité nous pensons rentabiliser nos investissements. Ces revenus nous permettront également de prendre en charge pendant trois ans les investissements nécessaires à la transition vers une agriculture biologique des jeunes exploitants.
Source : La tribune, 7/06/19
Questions :
A - En quoi la transformation en « société à mission » s’inscrit-elle dans l’histoire de l’entreprise ?
B - Concrètement en quoi consiste le passage au statut de « société à mission »
C - Comment une entreprise d'assurance peut-elle orienter les choix économiques et sociaux en faveur du bien commun ?
Voir la correction
A - En quoi la transformation en « société à mission » s’inscrit-elle dans l’histoire de l’entreprise ?
La MAIF avait le statut juridique de mutuelle ; son histoire est donc déjà ancrée dans une vision de l’entreprise dirigée vers ses sociétaires. Par ailleurs les engagements sociétaux du groupe sont forts au niveau de la gestion du travail et de l’environnement, comme en témoignent certaines certifications obtenues par l’entreprise.
B - Concrètement en quoi consiste le passage au statut de « société à mission » ?
Il s’agit d’abord de formuler explicitement la raison d'être de l’entreprise. Dans le cas de la MAIF, il s’agit de l’« d'attention sincère portée à l'autre » et au monde. Ensuite, il faut décliner cette ligne de force dans toutes les pratiques de l’entreprise. Par exemple, l’entreprise s’engage à conseiller ses sociétaires de façon individualisée et désintéressée. Cela a des conséquences sur le mode de rémunération des salariés de la MAIF.
Enfin, ces engagements sont évaluables et évalués.
C - Comment une entreprise d’assurance peut-elle orienter les choix économiques et sociaux en faveur du bien commun ?
L’exemple de la MAIF montre que même si une entreprise n’est pas directement en prise avec le tissu productif, elle peut orienter un certain nombre d’acteurs, consommateurs ou producteurs. Ici, en favorisant la filière du recyclage automobile, l’assureur contribue à limiter l’obsolescence et le gaspillage, avec un impact sur l'environnement. Par ailleurs, les choix de gestion de fonds d’investissement comme leviers de développement des énergies renouvelables, notamment solaires, ou encore en faveur de la transition vers une agriculture biologique sont des actes forts allant dans le sens du développement (durable) de nombreux acteurs.
5- L’entreprise : une force collective
Document : Mais qu’est-ce que l’entreprise ?
Depuis l'Antiquité, il existe des marchands, des affaires commerciales et des associés. Mais l’entreprise telle que nous la connaissons ne pouvait naître qu’à la fin du XIXe siècle, bien après la loi de 1867 qui libéralisait le statut juridique des sociétés anonymes. En effet, l’entreprise moderne est née de l’impact de la démarche scientifique sur l’activité productive et commerciale, et de la systématisation de l’invention de nouveaux produits par les ingénieurs et les créateurs. Entre 1890 et 1914, les effets de cette mutation sont spectaculaires : développement de la chimie, de l’électricité, du téléphone, de l’automobile, de l’avion, du cinéma, des plastiques…
A la différence de l’entrepreneur, qui organisait simplement la production dans la vie habituelle des affaires, l’entreprise forme un régime de création de richesses sans précédent. Cette nouvelle puissance collective transforme les repères culturels autant que les techniques et les connaissances ; elle bouleverse le monde universitaire et éducatif. Car sans la science, sans la conception industrielle, quelles richesses aurait pu créer le capitalisme, même le plus dynamique ?
D’où une seconde confusion : croire que l’entreprise est l’enfant du capitalisme et de la société anonyme. L’entreprise n’a pu exister qu’avec des principes renouvelant profondément le capitalisme : l’investissement scientifique et la création collective comme seules sources soutenables de profit ; un management autonome qui se fonde, en principe, sur la compétence et la confiance des personnels ; un droit du travail qui impose à tous la protection sociale des personnels.
Partout, ces principes ont mis la société anonyme au service de l’entreprise ; en Europe, ils ont souvent favorisé la participation des salariés à la gestion (codétermination).
Mais depuis les années 1980, ce cycle de développement s’est brisé. La société anonyme est devenue un outil financier au service d’un actionnariat mondialisé, organisé en fonds puissants, exigeant des dividendes élevés, certains et rapides. Trop souvent, elle sert de leurre fiscal sans lien avec l’activité de l’entreprise.
Alors, les inégalités salariales ont explosé ; l’emploi et les investissements n’ont plus suivi les profits. Ainsi, tout en aggravant le conflit capital-travail, la domination de la valeur pour l’actionnaire menace directement le potentiel d’innovation et d’engagement sociétal de l’entreprise, au moment même où l’humanité doit impérativement engager des transformations énergétiques et alimentaires majeures, où la réaction aux crises migratoires menace les démocraties.
La réforme nécessaire est donc bien celle de la société anonyme afin que, dans un cadre de droit adapté aux problèmes de notre temps, l’entreprise, non seulement, crée des emplois, mais contribue à inventer les techniques, les modes de vie et les formes de gouvernance du développement durable.
Source : Le Monde, A. Hatchuel , Un nouveau cadre de droit pour l’entreprise, 11/01/2018.
Questions :
A - En quoi l’entreprise moderne est-elle profondément liée à l’innovation ?
B - Pourquoi Armand Hatchuel insiste-t-il sur la définition de l’entreprise comme « puissance collective » ?
C - En quoi les années 1980 constituent-elles une rupture ?
Voir la correction
A- En quoi l’entreprise moderne est-elle profondément liée à l’innovation ?
L’entreprise moderne est née à la fin du XIXe siècle dans la mesure où les progrès scientifiques ont eu alors un impact considérable sur l’activité de production. L’invention de nouvelles techniques et de nouveaux produits par les ingénieurs a bouleversé la société tant au niveau de la consommation que de l’organisation spatiale (population rassemblée autour des usines) et de la structure sociale. Les innovations dans la chimie, l’électricité, l’automobile, les moyens de communication, etc. ont fait naître l’entreprise moderne comme acteur de transformation des modes de vie.
B- Pourquoi Armand Hatchuel insiste-t-il sur la définition de l’entreprise comme « puissance collective » ?
L’entreprise ne se résume pas à l’entrepreneur. Elle constitue, par définition, un « régime de création de richesses », comme l’écrit A. Hatchuel, car il est fondé sur un collectif. L’innovation, l’adaptation aux techniques, la mobilisation d’un groupe autour d’un objectif sont au cœur de la puissance collective de l’entreprise. Celle-ci ne peut exister sans une certaine confiance dans l’implication, la compétence de chacun.
C- En quoi les années 1980 constituent-elles une rupture ?
Les années 1980 sont celles de l’ouverture des marchés financiers à la mondialisation. Cette mutation a eu des impacts profonds sur le fonctionnement et la perception de l’entreprise. La gouvernance de la société est passée sous l’influence d’actionnaires nouveaux : un actionnariat mondialisé, en particulier des fonds financiers aux moyens puissants. La priorité de la gouvernance de ces sociétés cotées est donc devenue la « valeur actionnariale » c’est-à-dire l’évolution des dividendes et du cours de l’action. Cette rupture ne concerne pas les petites et moyennes entreprises de façon directe mais, via la sous-traitance, l’ensemble du paysage de l’entreprise est touché. Les décisions en matière d’emploi, de recherche, d’investissements et de localisation géographique sont conditionnées aux profits. A partir de là, l’engagement dans l’innovation et dans les enjeux sociétaux de l’entreprise sont secondaires.
6 - Entreprise et bien commun
Document :
(…) Les représentations de l'entreprise comme acteur de l'intérêt général et institution primaire de l'économie de marché se développent dans l'espace public de la Cité et ouvrent de nouvelles perspectives politiques en matière de démocratie industrielle. […] L'on a très souvent pu lire dans la presse soit que l'entreprise est un bien commun, soit qu'elle sert le bien commun. (…) Un bien commun au service du bien commun ? Cette réponse est peu satisfaisante d'un point de vue logique. (…) les travaux de deux économistes, Elinor Ostrom et Oliver Williamson, lauréats du Prix Nobel d'économie 2009, peuvent éclairer les termes du débat actuel. (…)
Pour Elinor Ostrom, un bien commun est un bien non-appropriable : personne ne possède l'entreprise d'un point de vue juridique. Et sa gouvernance - pour ne pas dire son auto-gouvernance - doit être assurée par la communauté des parties constitutives de l'entreprise de manière partagée pour en accroître son efficience et sa durabilité, donc sa préservation dans le temps. En d'autres termes, la firme en tant que bien commun serait une entité de création collective dont la gouvernance implique la participation de tous les acteurs qui font son existence. Ce qui inclut sans doute principalement les actionnaires, les dirigeants et les salariés. Si ces biens communs ne doivent pas être gouvernés par la main invisible du marché, ils ne peuvent pas non plus être gouvernés efficacement par la seule puissance publique. Dans un sens étendu, un bien commun peut donc être de nature privée.
Pour Oliver Williamson, qui a largement contribué au développement de l'économie de la firme, la raison d'être de l'entreprise est de créer un ordre privé interne spécifique. Encastré dans un ordre public mais basé sur des relations industrielles hiérarchiques, ce dernier peut ainsi insuffler l'ordre et la coopération, éviter les conflits organisationnels et accroître les gains mutuels issus de l'activité de production. Oliver Williamson considère alors que la logique privée de l'entreprise fondée sur ce qu'il nomme « un droit interne » en fait l'institution la plus efficace du capitalisme lorsque l'activité de production est complexe et spécifique. Si ces recherches nobélisées présentent certaines limites, elles s'avèrent néanmoins précieuses pour préciser la nature « collective » mais « privée » de l'objet « entreprise » que l'on souhaite aujourd'hui réformer et pour éviter les confusions conceptuelles qui accompagnent le débat.
Dans mes travaux académiques, je montre ainsi que la firme est un « bien commun privé » qui, par essence, contribue à l'intérêt général de la Cité. Par conséquent, je reste favorable à la reconnaissance raisonnable de l'entreprise, dans le droit positif, comme acteur d'un intérêt supérieur, social, économique et environnemental. Avec l'idée de ne pas la résumer aux seuls apporteurs de capitaux et de ne pas la laisser dans les méandres de la spéculation court-termiste et des dérives actionnariales. Mais je reste aussi persuadé que le processus de refondation et de démocratisation de l'entreprise ne saurait être légitimé et effectif sans une réflexion sur les mécanismes d'organisation et de coordination de cet ordre privé interne (qui est propre à la communauté qu'elle incarne) : les dispositifs de gouvernance, de responsabilisation, de représentation, de rétribution et de participation. Partant, l'entreprise est un acteur de l'intérêt général, car elle participe des conditions de développement de la société par la production, mais aussi de la personne par de nouveaux droits et devoirs associés.
Virgile Chassagnon est professeur des universités à la (UGA, CREG) et directeur de l'Institut de recherche pour l'économie politique de l'entreprise.
Source : lesechos.fr, 8/03/2018
LE DEBAT : L'entreprise peut-elle être à la fois au service du bien commun et préserver son objectif de rentabilité ?
Préparation du débat : A partir des documents qui précèdent, dégager des arguments permettant de nourrir la discussion.

LEXIQUE
- GOUVERNANCE : Ensemble des processus, des institutions, des réglementations encadrant la manière dont l'entreprise est dirigée, administrée et contrôlée.
- PARTIES PRENANTES : les parties prenantes (en anglais : stakeholder) sont les acteurs concernés par les décisions de l’entreprise, que ce soit de façon positive ou négative.
- RSE : la responsabilité sociétale des entreprises a été définie en 2011 par la Commission Européenne comme « la responsabilité des entreprises (RSE) vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société ». Il s’agit d’un processus permettant que la gouvernance de l’entreprise intègre les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l’homme et de consommateurs dans leurs activités commerciales et leur stratégie de base.
- SOCIETE A MISSION : nouvelles formes de sociétés commerciales qui se définissent statutairement, en plus de leur but lucratif, une finalité d’ordre social ou environnemental.