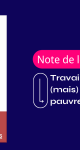Mots-clés : Pouvoir d’achat, Productivité, Répartition de la valeur ajoutée, Travail.
Résumé
Depuis un peu plus de deux siècles, c’est-à-dire depuis la fin de la société d’ordres et de privilèges de l’Ancien Régime, nous avons essayé de bâtir une société d’individus fondée sur le mérite et le travail.
Or, aujourd’hui, nous assistons à une rétrogradation du travail derrière l’héritage et la rente, et cette situation n’est pas tenable dans le temps. Comment reconstruire une société du travail au XXIème siècle ? L’ouvrage analyse les conditions de reconstruction d’une telle société.

Résumé
Depuis un peu plus de deux siècles, c’est-à-dire depuis la fin de la société d’ordres et de privilèges de l’Ancien Régime, nous avons essayé de bâtir une société d’individus fondée sur le mérite et le travail. Or, aujourd’hui, nous assistons à une rétrogradation du travail derrière l’héritage et la rente, et cette situation n’est pas tenable dans le temps. Comment reconstruire une société du travail au XXIème siècle ? L’ouvrage analyse les conditions de reconstruction d’une telle société.
L’ouvrage
La « société du travail » qui a réalisé depuis soixante ans un progrès économique et social permettant de vivre de mieux en mieux en travaillant de moins en moins est en train de disparaître, et cela parce que les trois propositions qui fondaient cette société laborieuse ne sont plus vérifiées.
La première de ces propositions était que le travail permet d’améliorer le niveau de vie. Or, depuis une quinzaine d’années en moyenne, le pouvoir d’achat n’augmente plus que de 0,8% par an contre 2% à la fin du siècle dernier et 5% pendant les Trente Glorieuses. Au rythme de progression actuel, il faudrait plus de quatre-vingts ans pour doubler son pouvoir d’achat en travaillant, ce qui signifie que pour la majorité des gens, travailler plus ne permet plus de changer de niveau de vie.
La deuxième proposition était que le patrimoine accumulé provient du travail. Et il est désormais établi que ce que nous possédons n’est plus majoritairement lié à notre travail : la fortune héritée représente aujourd’hui 60% du patrimoine total, contre 35% dans les années 1970, ce qui montre que le hasard de la naissance est repassé devant l’effort et le mérite individuels. On peut illustrer cette réalité en s’appuyant sur le cas des travailleurs les mieux rémunérés (les 1% les mieux rémunérés, à partir de 9000 euros nets par mois) qui ne peuvent plus acquérir, par toute une vie de travail, le patrimoine moyen des héritiers les plus chanceux (le top 1 % des héritiers d’une génération reçoit en moyenne 4,2 millions d’euros nets de droits).
La troisième proposition était que ceux qui ne travaillent pas vivent moins bien que ceux qui travaillent. Et maintenant, pour la première fois dans l’histoire, les retraités ont un niveau de vie en moyenne supérieur non seulement à l’ensemble de la population, mais également aux actifs : pour des raisons démographiques, on observe même que les pensions actuelles sont supérieures aux cotisations acquittées pendant la vie active, de 30% à 50 %.
Cette rétrogradation du travail derrière l’héritage et la rente n’est pas tenable dans le temps : jamais dans l’histoire une nation qui a préféré la naissance et la rente n’a pu maintenir son rang dans le monde. L’ouvrage s’efforce d’apporter une contribution à la compréhension de ce problème, et d’esquisser un chemin pour y répondre.
Il s’agit d’abord de poser un diagnostic clair et vérifiable par chacun. Sur quoi s’appuie-t-on pour dire que « le travail ne paie plus » ou, ce qui revient au même, qu’il ne permet plus de changer de niveau de vie ? Quelles sont les différences avec les générations précédentes ? En quoi la promesse d’émancipation par le travail est-elle en train de se rompre ?
Il faut ensuite s’efforcer de comprendre ce que l’on voit. D’où vient que le travail ne paie plus ? D’une mauvaise répartition de la valeur que nous créons collectivement ? D’un ralentissement de nos gains de productivité ? D’un accroissement des inégalités entre travailleurs ? Et dans ce registre, il faut aussi questionner nos choix collectifs, confirmés élection après élection, qui ont une part de responsabilité dans la situation que nous vivons.
Et après avoir fait la description du phénomène et fourni les clés de compréhension, il reste à en venir aux propositions. La conviction que l’auteur développe dans ce livre est que la France ne reconstruira jamais une société du travail au XXIème siècle sans faire de nouveaux compromis politiques et sociaux adaptés à notre nouvelle situation historique. Le défi que doit relever notre pays est de bâtir une société du travail qui ne repose plus comme par le passé sur l’obéissance et la nécessité, mais sur la réalisation individuelle au service de biens communs.
I- Le diagnostic
Depuis une quinzaine d’années, en matière d’évolution du travail, deux ruptures fondamentales se produisent.
La première rupture est que travailler ne permet plus à la grande majorité des travailleurs de changer de niveau de vie. D’après l’Insee, dans les années 1950 à 1970, avec une évolution moyenne du pouvoir d’achat autour de 4 à 6%, on doublait effectivement son niveau de vie en une quinzaine d’années de travail. Dans les trois décennies suivantes, où la progression annuelle tournait autour de 2%, il fallait plutôt une vie entière de travail, environ quarante ans. Et depuis une quinzaine d’années, avec une évolution du pouvoir d’achat qui tangente les 1% par an, il faudrait maintenant plus de quatre-vingts ans pour vivre deux fois mieux. Cette stagnation inédite du pouvoir d’achat ne touche pas uniquement les travailleurs modestes ou les classes moyennes, mais concerne toutes les classes sociales : entre 1998 et 2018, le niveau de vie moyen des 10% les plus riches a évolué encore plus lentement que le niveau de vie moyen des Français (+0,7% contre +0,8% par an).
La deuxième rupture réside dans le fait que pour la première fois depuis 1945, la durée annuelle du travail ne diminue plus. En effet, depuis la fin de la guerre, chaque génération travaillait moins que la précédente. Tous les vingt ans environ, une baisse significative de la durée du travail intervenait (environ 200 heures), soit par la pratique des entreprises, soit par la législation. La durée annuelle moyenne et effective du travail en France était ainsi d’environ 2230 heures en 1950, 2000 heures en 1970, 1700 heures en 1990. En revanche, en 2022, la durée du travail est la même que vingt ans plus tôt : environ 1600 heures. En même temps, les années de travail dans la vie ne diminuent plus, mais augmentent : en 1993, il fallait avoir travaillé 37,5 ans pour partir à la retraite ; c’est devenu 40 ans en 2003, 42 ans en 2024, 43 ans en 2027. En 30 ans, le nombre d’années de travail pendant la vie a augmenté de près de six ans.
Ces deux ruptures impactent le rapport au travail de trois manières différentes.
La première, c’est la résistance au travail qui est repérable à travers trois symptômes : les journées de manifestation contre les réformes qui reportent l’âge légal de départ à la retraite, l’extension de la démission silencieuse (« quiet quitting ») et la hausse constante et inédite des arrêts maladie.
Le deuxième type de réaction est la relativisation du travail qui n’est plus central dans la vie des individus. La hiérarchie des priorités est désormais inversée : la question n’est plus de savoir si le travail rend la vie intéressante, mais de se demander dans quelle mesure tel ou tel emploi va permettre à l’individu de vivre sa « vraie vie », qui est ailleurs que dans le travail.
Et la troisième réaction, à la fois contradictoire et complémentaire avec les deux autres, est l’investissement existentiel dans le travail. Puisque le travail ne permet plus de changer de niveau de vie, et puisqu’il va falloir travailler davantage que les générations précédentes, alors au moins que ce travail ait un sens. C’est cette recherche de sens qui explique l’apparition du concept de « jobs à la con » (« bullshit jobs »), révélant en creux la frustration de nombreux salariés qui considèrent que leur travail n’a pas, ou trop peu, de sens.
Voir le fait d'actualité : « Les salaires évoluent moins vite que l’inflation en France »
II- D’où vient que le travail ne paie plus ?
La stagnation générale et durable du pouvoir d’achat provient d’abord du ralentissement des gains de productivité. Comme le dit Paul Krugman, prix Nobel d’économie 2008, « la productivité n’est pas tout, mais dans le long terme elle est presque tout. La capacité d’un pays à améliorer son niveau de vie dépend presque entièrement de sa capacité à faire progresser sa production par travailleur ». Pendant les Trente Glorieuses, l’amélioration continue de la productivité a permis une élévation accélérée et générale du niveau de vie pendant plusieurs décennies, créant ainsi les classes moyennes. Nous sommes en train de vivre le phénomène exactement inverse : la productivité progresse beaucoup moins vite depuis quarante ans et s’est quasiment interrompue depuis quinze ans, entraînant une stagnation du pouvoir d’achat et frappant de plein fouet les classes moyennes qu’elle avait fait naître.
Les causes du ralentissement de la productivité sont au nombre de quatre. D’abord, la désindustrialisation : c’est dans l’industrie que les gains de productivité sont les plus forts. Or, en quarante ans, la part de l’industrie manufacturière dans la valeur ajoutée nationale a baissé de 24% à 10%, faisant de la France le pays du G7 le plus désindustrialisé, encore plus désindustrialisé que le Royaume-Uni. Deuxième cause : les emplois industriels ont été remplacés par des emplois très polarisés dans les services, c’est-à-dire d’une part des emplois très qualifiés et bien rémunérés, d’autre part des emplois peu qualifiés et peu rémunérés (hôtellerie, restauration, sécurité, propreté, aides à domicile…), dont la productivité est faible. La troisième raison est que le système éducatif français est devenu peu performant (voir OCDE, « PISA 2022 results ») : de plus en plus de pays, dans lesquels les travailleurs sont plus éduqués et mieux formés que chez nous, sont plus productifs que la France, innovent davantage, et inventent des évolutions technologiques dont ils captent la plus grande partie de la valeur. Enfin, quatrième et dernière raison, il y a une inadéquation croissante entre les formations choisies et les compétences attendues par les entreprises. La France n’ajuste pas vraiment l’offre de formation en fonction des besoins en compétences de l’économie nationale, et cela se traduit à la fois par une sous-qualification et une surqualification par rapport aux emplois existants, ce qui est à la fois une source de frustration pour les travailleurs et une perte de productivité pour les entreprises.
Mais la stagnation du pouvoir d’achat provient également des choix collectifs qui ont été faits. Le premier choix a consisté à mutualiser une part de plus en plus importante des richesses que nous créons en travaillant. En quarante-cinq ans, nos dépenses publiques ont augmenté de 11 points de PIB, passant de 46% à 57% du PIB. Et ce prélèvement colossal ne sert pas à mieux financer nos services publics et nos équipements collectifs, mais à assumer la hausse de nos dépenses de protection sociale, qui ont représenté la totalité de notre effort collectif supplémentaire. Mécaniquement, une plus grande mutualisation de la richesse collective s’est traduite par un prélèvement plus élevé sur la richesse individuelle, et notamment sur les salaires gagnés. Si les travailleurs touchant le SMIC ont été relativement épargnés, il n’en est pas de même pour le salaire moyen, égal à 2630 euros nets mensuels aujourd’hui : sur 100 euros gagnés, ces travailleurs en gardaient 69 en 1968, et 54 de nos jours. Le deuxième choix a consisté à solliciter beaucoup moins les autres sources de revenus que ceux liés au travail. Nous avons choisi de taxer le travail beaucoup plus que le capital, l’héritage ou les retraites. Sur le travail, on prélève des cotisations sociales, la CSG, la CRDS et l’impôt sur le revenu (IR), soit en moyenne 46% du revenu total. Sur les revenus du capital (par exemple les dividendes), on applique un prélèvement forfaitaire unique de 30%. Sur les pensions de retraite, le taux moyen est de 14%. Et sur l’héritage, on applique des droits de succession dont le taux effectif est en réalité de 6%, en raison des abattements et exonérations. Autrement dit, en France en moyenne, quand on gagne 100 euros en travaillant, on en garde 54. Quand on gagne 100 euros en investissant, on en garde 70. Quand on gagne 100 euros avec sa pension de retraite, on en garde 86. Quand on gagne 100 euros en héritant, on en garde 94.
Voir la note de lecture du livre de Jean-Hervé Lorenzi et Alain Villemeur « Partage vertueux entre salaires et profits »
Voir la note du CAE n°75 de septembre 2022 « Cap sur le capital humain pour renouer avec la croissance de la productivité »
III- Les propositions
Comment faire en sorte que le travail améliore notre niveau de vie, ne soit pas un obstacle à la vie familiale et privée, et ait aussi un sens permettant d’apporter une réponse collective à la question « pourquoi travailler ? ».
Au niveau du pouvoir d’achat, il faut distinguer une réponse de long terme d’une réponse de court terme.
La réponse de long terme est de renouer avec les gains de productivité, et donc de réindustrialiser et d’innover dans tous les domaines. La réindustrialisation implique des choix d’investissement, de fiscalité, de réglementation, de compétitivité, qui demanderont des efforts collectifs et une discipline nationale dans la durée. Pour renouer avec les gains de productivité, il faudra aussi remonter le terrain perdu en matière d’éducation, de formation et de compétences. Si nous parvenons à relever le niveau de nos élèves en primaire, nous en verrons les effets sur le marché du travail dans quinze à vingt ans.
A court terme, et comme on l’a vu plus haut, il est nécessaire d’agir sur la taxation des différentes sources de revenus. En d’autres termes, pour augmenter significativement les revenus du travail, il serait bon d’agir soit sur la baisse de l’impôt sur les revenus du travail soit sur celle des cotisations salariales (la forme la plus juste étant la baisse des cotisations salariales puisque les travailleurs dont les salaires sont les plus faibles ne paient pas l’impôt sur le revenu). Et pour compenser cette baisse de recettes pour les finances publiques, il serait opportun de demander un effort de la part de tous les rentiers, des retraités les plus aisés, des héritiers les plus chanceux et des consommateurs (pour y parvenir, on peut augmenter la CSG sur les revenus du capital, augmenter aussi l’impôt sur les successions des héritiers les plus fortunés, demander un effort aux retraités dont la pension est supérieure au salaire médian, et augmenter également les taux de TVA en fonction des priorités nationales que sont la santé, la justice sociale, la réindustrialisation, ou encore la décarbonation).
Evidemment, un tel big bang ne peut voir le jour que s’il est décidé et assumé par la collectivité nationale. C’est la raison pour laquelle Antoine Foucher propose d’agir par référendum. Un tel référendum sur le travail pourrait permettre de dépasser les oppositions et les clivages qui traversent la société française, et ainsi créer un moment de réconciliation entre la Nation et ses élites autour de la place du travail dans la société.
Une dernière proposition d’Antoine Foucher pour retrouver un travail qui paie est l’actionnariat salarié. A ce jour, et malgré des incitations fiscales et sociales importantes, seulement six cent mille salariés, soit un salarié sur trente, sont actionnaires de leur entreprise, et cela n’est pas un hasard car l’ouverture du capital de l’entreprise aux travailleurs fait encore en France l’objet de fortes résistances, aussi bien du côté de certains syndicats que d’une majorité du patronat. Au fond, c’est le projet de participation de de Gaulle qu’il faut remettre sur le métier, et qui s’appuie sur un triple fondement moral (chacun devient responsable de la marche de l’œuvre collective), politique (faire sur le plan économique l’équivalent des droits et devoirs du citoyen) et économique (mieux rémunérer les travailleurs en les associant à la prospérité de l’entreprise).
Et au-delà de toutes les mesures précédentes, Antoine Foucher propose d’esquisser un nouvel idéal de travail permettant à chacun de choisir son travail et de s’épanouir, ce qui suppose de créer de nouveaux droits pour les travailleurs permettant d’organiser son travail et de changer de travail au cours de sa vie, et également de fixer la quantité de travail que chacun doit à la collectivité pour que le modèle puisse fonctionner au bénéfice de tous. On peut ainsi espérer construire pour les travailleurs du XXIème siècle une société dans laquelle le travail librement choisi et correctement rémunéré permet de contribuer à un bien commun qui nous dépasse et nous grandit.
Voir les notes de lecture :
du livre de Gilbert Cette « Travailleur (mais) pauvre et du livre de Daniel Susskind « Un monde sans travail »
Quatrième de couverture
Depuis 1945, de génération en génération, on vivait de mieux en mieux, en travaillant de moins en moins, grâce à un travail de plus en plus productif. C’est malheureusement terminé. Or à quoi sert le travail quand il ne permet plus d’augmenter son niveau de vie ? Antoine Foucher plaide pour un nouveau contrat social, fondé sur le travail, pour cesser de nous fracturer er redevenir maîtres de notre destin collectif. Ainsi qu’il le démontre, le travail est ce qui nous divise le moins : à condition qu’il nous permette de mieux vivre et de nous épanouir, c’est un bien désiré par le plus grand nombre et qui fait en même temps notre force collective. Tel est donc notre défi, inédit dans notre histoire : bâtir une société du travail qui ne reposerait plus sur l’obéissance ou la nécessité, mais sur la réalisation individuelle au service de biens communs.
« Une réflexion forte et engagée sur le travail, essentielle en cette période bousculée pour redonner du sens à ce qui est l’un des ciments de nos sociétés ». Laurent Berger, directeur de collection.
L’auteur
Antoine Foucher : Spécialiste des questions sociales, ancien directeur de cabinet de la ministre du travail de 2017 à 2020, dirige aujourd’hui le cabinet Quintet. Il est l’auteur de Le monde de l’après-Covid (2022) chez Gallimard.