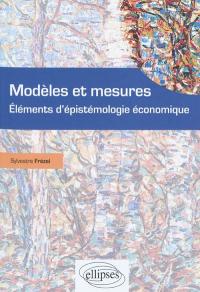L'ouvrage
Les économistes ont été durement atteints par la crise économique et financière 2007-2009. Un certain nombre de critiques sont revenues de manière récurrente : une foi excessivement optimiste dans les vertus autorégulatrices de la finance de marché durant la période de croissance et de stabilité des prix, un attachement trop grand à la modélisation mathématique, une spécialisation trop poussée des travaux (comptabilité, finance, économie industrielle, macroéconomie internationale) empêchant une vision d’ensemble, une trop faible incitation à produire des travaux en dehors du « mainstream », le courant de pensée dominant, voire une complaisance vis-à-vis des milieux financiers. Pour autant, si la démarche scientifique des économistes mérite d’être questionnée, les remises en question trop radicales et globalisantes ont souvent versé dans le relativisme, brocardant la possibilité même d’une analyse scientifique du monde social.
Malgré l’existence de publications plus critiques sur l’efficience des marchés dans le domaine de la finance et de quelques voix dans la profession (parmi lesquelles Nouriel Roubini, Raghuram Rajan, Michel Aglietta, Robert Shiller, Barry Eichengreen, etc.) qui ont attiré l’attention sur l’accumulation des déséquilibres et la montée des périls, au risque de passer pour des Cassandre, il est vrai que les économistes n’ont pu anticiper la gravité des dérèglements financiers, jetant un certain discrédit sur leur corporation. A tel point que la crise du capitalisme financier a pu s’apparenter à celle de la science économique, « la plus scientifique des sciences sociales et la plus politique des sciences exactes » pour reprendre une formule de l’économiste Christian Stoffaës. Malgré ses failles, l’économie offre pourtant de puissants outils analytiques pour mieux comprendre le monde contemporain. Sylvestre Frézal, professeur d’économie à Sciences-Po publie un petit ouvrage particulièrement stimulant sur l’épistémologie de l’économie chez Ellipses : « A l’écoute d’une analyse économique – quelques phrases à la radio ou bien quelques lignes dans le journal –, note-t-il dans son introduction, deux types de réactions spontanées, polaires, émergent souvent.
Le premier est une adhésion sans réserve. De fait, le raisonnement proposé est un enchaînement logique, le chiffre avancé est par nature objectif : logique, objectif, donc dont la conclusion est incontestable. Le second est un rejet sans appel. De fait, le raisonnement a omis de prendre en compte certains aspects de la réalité, le chiffre est biaisé ; sa conclusion est donc sans valeur. Généralement on adopte l’un ou l’autre de ces types de réaction en fonction de ses conclusions à notre idéologie. Ceci accrédite la vision de l’économie non comme une analyse objective, technique, mais comme une opinion, relevant du domaine politique ». Si, selon l’auteur, toute pensée a besoin, pour développer ces raisonnements, de simplifier le réel en l’abordant sous un angle donné, la tentation est grande selon lui de rejeter le raisonnement simplifié au prétexte que tout n’est pas si simple : hélas « de nombreux étudiants, de nombreuses personnes, faute de recul épistémologique sur les enseignements qui leur sont fournis ou bien par idéologie, ont tendance à se situer dans cette catégorie ».
Sylvestre Frézal rappelle que toute pensée, qu’elle soit réfléchie ou impromptue, repose sur une modélisation : « cette modélisation peut être consciente ou inconsciente, formalisée ou non, implicite ou explicite, mais elle constitue un socle nécessaire à tout raisonnement, à toute observation ». Si l’économie est la science sociale qui est la plus proche des sciences de la nature puisqu’elle recourt à des modèles formalisés (littéraires ou mathématisés) qu’elle confronte à la réalité empirique en utilisant la mesure, l’objet qu’elle étudie n’est pas celui des sciences de la nature : proche du pouvoir et de la décision politique, son ambition est perpétuellement menacée de devenir non scientifique et de servir les idéologies.
Une démarche scientifique
Le chapitre introductif s’interroge sur la démarche scientifique et, citant Poincaré (« une accumulation de faits n’est pas plus une science qu’un tas de pierre n’est une maison »), l’auteur rappelle les fondements historiques de la construction du savoir raisonné dans un cadre formalisé (évoquant notamment la Grèce Antique, les mathématiques et Thalès), mais aussi ses racines philosophiques, citant Bergson : « Tous, anciens et modernes, s’accordent à voir dans la philosophie une substitution du concept au percept. Tous en appellent à l’insuffisance de nos sens, aux fonctions d’abstraction, de généralisation et de raisonnement ». Mais il montre que la science va plus loin dans l’analyse du lien causal, puisqu’elle passe du « donc » au « pourquoi » et d’une constatation à une recherche par un raisonnement logique. Rappelant que pour progresser, la science économique a dû faire appel à des concepts abstraits incontournables (comme l’utilité, l’aversion au risque, la préférence pour le présent, l’inflation), le caractère abstrait de ces concepts ne permet en rien de disqualifier la pertinence d’une analyse s’appuyant sur eux : « l’essence de la science est d’abstraire pour pouvoir généraliser ». D’ailleurs, selon Sylvestre Frézal, dans le cadre des débats sur la mesure du pouvoir d’achat, « la critique récurrente à l’heure actuelle de la mesure de l’inflation « perçue » plutôt que l’inflation « réelle » marque une régression de près de deux millénaires et demi ».
Le philosophe des sciences Gaston Bachelard affirmait dans son ouvrage La Formation de l’esprit scientifique que « l’instrument de mesure finit toujours par être une théorie et il faut comprendre que le microscope est un prolongement de l’esprit plutôt que de l’œil ». Le travail de l’économiste s’inscrit dans cette tradition et dans son premier chapitre, Sylvestre Frézal insiste sur l’importance de la modélisation dans les sciences économiques (« il faut simplifier pour appréhender », « il faut découper pour étudier », « il faut formaliser pour réfléchir ») : « si le talent du vulgarisateur est de vulgariser le connu, le talent du scientifique ou de l’artiste, c’est de vulgariser l’inconnu ». Prenant l’exemple d’un enfant qui dessine sommairement un bonhomme comme représentation stylisée de la réalité, il rappelle qu’un modèle n’est pas la vérité et n’a pas la prétention à l’être (tentative de mise en cohérence d’observations et « artefact de la pensée nous permettant d’appréhender certains aspects de la réalité »). Sans des modèles nécessairement réducteurs, le foisonnement du réel nous éblouirait et nous ne pourrions gérer la quantité d’informations.
Nous devons donc accepter de simplifier le réel, quitte à perdre de l’information. La construction du modèle est confrontée à l’impératif de la simplicité (« l’artiste devant l’exigence protéiforme des phénomènes, a besoin de se réfugier dans la simplicité démesurée », Thomas Mann) mais aussi à celui de la précision, d’où l’importance de l’échelle de grandeur (« si un modèle est une épure, il est une caricature »). L’auteur prend comme exemple le modèle de concurrence pure et parfaite où « l’économiste commence par décrire un monde utopique lourdement chargé d’hypothèses qui permettra ensuite de se rapprocher de la réalité en relâchant les hypothèses une par une par une critique de cette épure (en y ajoutant les interactions stratégiques, les externalités, les asymétries d’information, etc.) ». Il rappelle qu’un modèle ne peut être bon que si l’utilisation l’est, et il ne peut tout au plus fournir que des éclairages. Dans ces conditions, il faut se garder du piège qui consiste à perdre son esprit critique face à un modèle dont les enseignements nous confortent dans nos préjugés : « rien n’est pire qu’un modèle instrumentalisé inconsciemment, par facilité ou par ignorance épistémologique ». C’est la raison pour laquelle on ne peut se passer selon l’auteur de purs concepts comme « l’utilité » chez les économistes ou la « masse » chez les physiciens : c’est leur portée générale et non leur réalisme qui forge leur légitimité à appréhender le réel.
L’importance du sens de la mesure
Dans un deuxième temps, Sylvestre Frézal montre l’importance de la mesure comme outil empirique permettant de valider ou de réfuter. Il s’appuie sur un problème économique simple, à savoir celui de l’impact d’une hausse du salaire minimum (le SMIC en France) sur le chômage. « Premier raisonnement : si les salaires augmentent, les revenus augmentent, donc la consommation augmente, donc le chômage baisse. Second raisonnement : si les salaires augmentent, le coût du travail augmente, donc les délocalisations augmentent et des ouvriers trop coûteux sont remplacés par des machines, donc l’emploi diminue, donc le chômage augmente. Les deux raisonnements sont justes. Pourtant, ils sont contradictoires. Leurs conséquences s’opposent, et pour savoir quel effet est prépondérant, la mesure est nécessaire. On pourrait avoir une conviction a priori sur la force quantitative relative de ces deux effets, mais ce ne pourrait être une conviction que dans le sens le plus obtus du terme, de préjugé ». En ancrant les raisonnements dans la réalité, la mesure permet de passer de la logique à la science. Dans son troisième chapitre (« L’économique parmi les sciences ? ») l’auteur interroge plus particulièrement la spécificité du raisonnement économique : « ontologiquement [l’économique] est donc une science de la gestion des ressources rares ; pratiquement une science des incitations, c’est-à-dire une science de la gestion d’information, fondamentalement, une science des comportements humains ». L’analyse économique repose sur une description des comportements des agents (comme les individus, les entreprises, etc.) où ceux-ci tentent de maximiser, étant donné les contraintes qui s’imposent à eux, leur satisfaction, leur bien-être, leur utilité.
C’est en ce sens que les économistes utilisent l’hypothèse de rationalité, au sens où l’individu agit de manière cohérente avec ses objectifs compte tenu de ses contraintes (la rationalité ne signifiant pas forcément que l’individu est toujours « intéressé »). Si cette hypothèse peut paraître restrictive, elle demeure indispensable pour déterminer un enchaînement causal. Le domaine de validité des théories économiques est donc nécessairement borné par le délicat arbitrage entre « la simplicité du maniable et la complexité du réel » : les modèles des économistes sont enrichis progressivement afin de mieux rendre compte des différents paramètres au cœur des phénomènes économiques (arbitrage entre présent et futur, intérêt personnel et altruisme, tolérance aux inégalités, etc.). C’est la raison pour laquelle de nombreux travaux ont eu pour but d’enrichir la notion de rationalité en économie, tels ceux d’Herbert Simon en termes de rationalité limitée, qui intègrent rationnellement les coûts d’acquisition et de traitement de l’information. Pour Sylvestre Frézal, l’économie théorique vise ainsi à appréhender des mécanismes comportementaux par une décomposition des raisonnements logiques, en s’attachant à décrire un enchaînement causal au sein d’un cadre cohérent. Rappelant que les mathématiques ne peuvent appréhender les notions de causalité (« une équation décrit une corrélation et non une causalité ») et qu’en conséquence, l’économie ne peut se passer du langage littéraire, il montre que la causalité constitue tout à la fois la pierre angulaire de la science mais aussi sa fragilité intrinsèque. En effet, « dès lors qu’une science théorise, c’est-à-dire qu’elle invente un lien causal, elle devient foi (…) Il y a inévitablement une dimension esthétique derrière (c’est l’intuition causale qui constitue le cœur de la construction scientifique) ».
Une fonction périlleuse
Sylvestre Frézal compare la physique et l’économie en évoquant de front le traditionnel problème du complexe de l’économiste en quête d’une scientificité équivalente, mais note que « la foi est parfois plus présente dans la physique que dans l’économique ». En effet, l’économiste dispose d’une connaissance interne des causes, puisque chaque individu fait des choix, et l’économiste sait donc quels sont les motifs qui y président. La causalité est donc davantage fondée en économie qu’en physique selon l’auteur. Pour autant, « croire en l’économique peut être un acte de foi bien plus dangereux […] En physique, la foi est certes purement idéologique, mais on sait que ses conséquences sont validées ; en économique la foi n’est que largement idéologique, mais ses conséquences ne sont que partiellement validées, et, pire, elles ne sont probablement que partiellement validables », notamment en raison du poids de l’hypothèse « toutes choses égales par ailleurs » qui exprime un « besoin non assouvi de quantification » que la physique assure plus efficacement.
Mais la « malédiction de l’économie » consiste dans une différence fondamentale avec la physique : cette dernière a surtout été créée pour comprendre, tandis que l’économie intègre également l’objectif d’agir et de dominer la nature, d’où la fonction périlleuse de l’économiste comme « conseiller du Prince », qui s’écarte de la science et de sa vocation froidement analytique. En définitive, comme tout scientifique, l’économiste se doit de viser deux équilibres : il doit approximer avec pertinence dans le cadre de ses modèles (« hiérarchiser et négliger à bon escient ») en se défiant des préjugés souvent faux ; et il doit impérativement s’appuyer sur des données robustes (« être un scientifique plutôt qu’un simple penseur »), même si le recours à l’intuition reste nécessaire pour interpréter des faits qui sinon resteraient muets. Sylvestre Frézal insiste enfin sur le fait que « la scientificité de l’économique est limitée par une rationalité imparfaite, dans la mesure où elle ne peut reposer sur des expérimentations […]. Mais de toute façon, une science ne produira jamais de vérité, tout au plus des vérités en sursis ».
L'auteur
- Sylvestre Frézal est directeur du cycle de licence de Sciences Po pour le campus de Paris. Polytechnicien, statisticien-économiste de l’ENSAE, il a reçu un prix d’option de l’Ecole polytechnique pour ses travaux de recherche en économie et a travaillé dans la régulation du secteur financier, contrôlant notamment les modèles de risques de grands groupes d’assurances. Il a également enseigné à l’université Paris-Dauphine.
Quatrième de couverture
Toute modélisation ou mesure consiste à choisir d’abandonner telles informations pour mieux analyser telle autre et ainsi mieux appréhender le réel. Cet ouvrage explique comment le faire avec pertinence, dressant les parallèles et les différences entre physique et économie, et puisant ses exemples dans des domaines très variés : art, sciences sociales, sciences « dures », finance…L’étude de la nature, des qualités et des limites des modèles et des mesures en science conduit alors à s’interroger sur la scientificité de l’économie. Sont ainsi successivement analysés la pertinence de l’hypothèse de rationalité et ses conséquences, le recours au formalisme mathématique, la dimension politique ou technique de l’analyse économique, la possibilité de mener des expérimentations, etc. Complément essentiel à tout manuel d’économie, ce livre s’adresse aux étudiants en économie désireux d’avoir un recul épistémologique sur cette discipline, ainsi qu’à tout étudiant en sciences ou en sciences sociales confronté quotidiennement aux modèles et aux mesures.