 |
Ecouter le podcast |
L'ouvrage
Dans cet ouvrage, Joseph E. Stiglitz et Bruce C. Greenwald rendent hommage à Kenneth J. Arrow, co-prix Nobel d’économie 1972 (avec Sir John Hicks) qui a, dans le cadre de ses articles fondateurs de 1962, décrit le rôle fondamental du progrès technique, de la recherche & développement, et plus particulièrement celui de l’impact de « l’apprentissage par la pratique », préludes aux théories de la croissance endogène. Dans la mesure où les marchés peuvent être soumis à des défaillances, un champ de réflexion s’ouvre alors selon eux sur les décisions de politique économique les plus pertinentes à prendre pour élever la productivité et les niveaux de vie, non seulement dans les pays avancés, mais aussi dans les pays émergents. Si, comme l’avait montré un autre grand économiste dont ils saluent les travaux, Robert Solow, les progrès du niveau de vie ont pour origine les gains de productivité, et que ces derniers sont endogènes (liés à l’apprentissage), faire en sorte que l’on apprenne davantage doit constituer une préoccupation centrale des pouvoirs publics.
Pour Joseph E. Stiglitz et Bruce C. Greenwald, l’Etat doit chercher à accroître les aptitudes et les incitations à apprendre, et même à apprendre à apprendre (« créer un état d’esprit de l’apprentissage »), de manière à combler les écarts de savoir séparant les entreprises les plus productives de toutes les autres. En effet, les auteurs citent leurs travaux de recherche en économie qui montrent que l’apprentissage constitue le fondement de la croissance et du développement sur longue durée : le rôle de l’Etat est donc de créer ce qu’ils désignent comme une « société de l’apprentissage » où les connaissances se diffusent dans tout le système productif et permettent de faire émerger une économie plus productive et donc plus prospère. Les sociétés peuvent influencer le flux de connaissances et l’apprentissage, car ces flux sont sensibles aux politiques publiques, aux institutions, à la conception des structures économiques et aux allocations de ressources (tant aux allocations sectorielles qu’aux choix de techniques).
Les auteurs estiment même que ce qui distingue la modernité occidentale, sur les deux cents dernières années, des millénaires de stagnation économique qui l’ont précédé, c’est ce processus cumulatif d’apprentissage qui nous a appris à être sans cesse plus productifs, à créer plus de produits avec des intrants. Le fil conducteur de leur livre repose sur la problématique suivante : quelle est la meilleure façon d’encourager l’apprentissage, et comment trouver l’équilibre optimal entre les gains dynamiques d’un apprentissage plus rapide et les coûts à court terme liés aux interventions ? Et comment concevoir au mieux ces interventions ? Contrairement aux préceptes du « consensus de Washington », qui supposait l’harmonie naturelle des intérêts et l’allocation efficace des ressources dans le cadre de marchés libres, les auteurs considèrent en effet que « l’Etat a un rôle important à jouer pour modeler une économie innovante et encourager l’apprentissage ». Ils plaident ainsi dans cet ouvrage pour une stratégie macroéconomique d’ensemble qui n’hésite pas à battre en brèche les idées reçues notamment sur la politique industrielle et la politique commerciale.
Lire le cours de terminale ES sur les sources de la croissance :
Pour une économie de l’apprentissage
Pour Joseph E. Stiglitz et Bruce C. Greenwald, dans nos pays avancés, on a d’autant plus de chances d’améliorer le niveau de vie et de créer une société apprenante que l’on est en mesure de réaliser de petits gains ponctuels d’efficacité économique, sans forcément sacrifier la consommation d’aujourd’hui pour accroître l’intensité en capital. Cette « distance au savoir » peut aussi expliquer les écarts de revenu par habitant persistants entre les pays émergents et les pays développés (« se développer signifie, entre autres, apprendre à apprendre »). Il s’agit alors pour les entreprises, qui en sont souvent éloignées, de rejoindre le point où elles exploitent au mieux la courbe de leur possibilité de production. Cette aptitude à l’apprentissage a alors un impact beaucoup plus fort sur le bien-être matériel que l’amélioration de l’efficacité de l’allocation des ressources et leur accumulation. Néanmoins, laissés à eux-mêmes, les marchés ne sont efficaces ni pour le niveau ni pour la structure de l’innovation. Conformément aux intuitions de Kenneth J. Arrow, les inefficacités du marché engendrent des entraves à la production et à la diffusion du savoir (tant dans l’allocation des ressources à la recherche & développement que dans l’apprentissage). Le retard de développement de certains pays s’explique donc par l’inaptitude à adapter la technologie mondiale existante et à déployer efficacement les ressources au sein de chaque secteur de l’économie. Cette difficulté laisse alors les pays bloqués bien en deçà de leur frontière théorique des possibilités de production.
L’enjeu pour les pays avancés, quant à eux, est plutôt de déplacer la frontière des possibilités de production, à tout le moins de permettre déjà à toutes les entreprises d’atteindre leur niveau de production optimal. Et il apparait que bien souvent les économies et les entreprises, même celles qui fonctionnent bien, opèrent hélas bien en deçà de leurs frontières des possibilités de production. Joseph E. Stiglitz et Bruce C. Greenwald préconisent alors trois voies à suivre pour les économies développées : créer un environnement propice permettant aux entreprises d’apprendre vite à améliorer leur productivité, de converger vers les bonnes pratiques ; distordre l’allocation des ressources en faveur des secteurs où l’on apprend plus, et où ce qui est appris déborde plus sur le reste de l’économie grâce aux externalités positives du savoir ; investir davantage pour stimuler la recherche-développement et inciter à « apprendre à apprendre ».
Reprenant la phrase d’Isaac Newton, « j’ai vu plus loin car j’étais juché sur des épaules de géants », ils défendent l’idée que dans une économie mue par l’innovation, l’accumulation du savoir est endogène, liée aux « catalyseurs » que l’économie propose, et par l’expérience pratique qui pousse à chercher des solutions (« one problem, one technology »), au contact avec les autres, grâce au commerce international qui plonge les entreprises exportatrices dans la concurrence. Mais sans doute aussi à la faveur d’un cadre cognitif qui crée un état d’esprit tourné vers l’apprentissage et l’amélioration de l’efficacité productive. C’est la raison pour laquelle un système éducatif qui favorise un esprit d’entreprise et d’initiative est ici déterminant, comme d’ailleurs le respect des valeurs des Lumières et celles de la science, pour créer un cercle vertueux puisque, « les sociétés dynamiques, où il y a davantage de changement, suscitent une plus forte demande d’apprentissage, et récompensent mieux ceux qui savent apprendre ».
Lire l’article de Mathieu Mucherie sur l’innovation
Joseph E. Stiglitz et Bruce C. Greenwald insistent sur les innovations des grandes entreprises industrielles, qui nécessitent de la stabilité et de la continuité sur le plan organisationnel, une accumulation du capital humain, une circulation des connaissances, et un accès au système financier. Ils notent que ces grandes entreprises peuvent être les plus à même de supporter les risques liés à l’innovation et d’avoir accès aux fonds nécessaires pour la financer.
Critiquant la thèse de la régulation par la faillite des économistes libéraux et de la vertu des crises comme assainissement du système productif, dans le cadre du processus de « destruction créatrice » cher à Joseph Schumpeter, les auteurs soutiennent au contraire que l’accumulation du savoir a besoin de stabilité macroéconomique et un « lissage » des fluctuations économiques par des politiques monétaire et budgétaire actives. En effet, la destruction des entreprises en raison de la récession peut se traduire par une disparition du capital informationnel et limiter les effets de débordements du savoir sur les autres secteurs de l’économie. Les crises et les récessions sont donc nocives à l’accumulation du capital humain et à l’apprentissage, et peuvent faire chuter la courbe des possibilités de production à long terme.
Sur le plan de la structure des marchés et de la concurrence, les auteurs apportent quelques éléments à l’appui de la thèse de Schumpeter : les marchés dominés par une seule entreprise en position de monopole peuvent être plus innovants que les marchés concurrentiels, mais ils jugent que l’économiste autrichien a gravement sous-estimé les moyens et les incitations du monopoliste installé sur le marché, qui peut ensuite dissuader toute nouvelle entrée, et ériger des barrières pour empêcher que son monopole soit « challengé ». C’est la raison pour laquelle un monopole durable peut devenir néfaste à l’innovation et à l’accumulation du savoir. Ils soulignent ainsi l’effet limité de la concurrence sur les positions de rente contrairement aux enseignements des modèles standards de la théorie économique. La relation entre le niveau de la concurrence (tant pour le marché que sur le marché) est donc extrêmement complexe, et il n’y a aucune preuve générale de l’efficacité de marché à produire automatiquement de l’innovation. Ce constat ouvre alors sur les bonnes incitations que l’Etat doit créer pour favoriser l’émergence d’une économie de l’apprentissage.
Lire la note de lecture du livre de Daniel Cohen :
Une politique économique de l’innovation
Joseph E. Stiglitz et Bruce C. Greenwald considèrent qu’il n’existe pas de système économique idéal pour susciter l’innovation : en effet, une économie de l’apprentissage performante peut naître tant dans une économie comme les Etats-Unis où les marchés sont très peu régulés (même si l’Etat intervient davantage qu’on le croit), mais aussi dans les pays du Nord de l’Europe, où un Etat providence développé et des inégalités réduites peuvent soutenir la prise de risque et limiter les coûts de l’échec. Ainsi, selon les auteurs, « peut-être n’est-il pas optimal que tous les pays suivent la même voie, mais ceux qui aspirent à être sur la frontière technologique devraient au moins envisager d’imiter certains aspects du modèle qui, dans les pays nordiques, a si bien réussi à maintenir un taux de croissance élevé, non seulement de la productivité mais aussi des niveaux de vie ». Dans les pays nordiques, un cercle vertueux s’est créé (« l’innovation façonne notre société, et notre société façonne l’innovation ») : le régime politique soutient les stratégies qui facilitent l’innovation et fait en sorte que les avantages de la croissance qui en résulte soient largement partagés. C’est donc à l’Etat de faciliter la transition d’une économie stagnante à une économie apprenante dynamique : son rôle est de concevoir des interventions optimales qui équilibrent les distorsions de court terme par des avantages de long terme autour de l’accumulation du savoir.
Joseph E. Stiglitz et Bruce C. Greenwald insistent tout d’abord sur le rôle des politiques commerciales : sans plaider pour l’autarcie, ils estiment que le libre-échange n’est pas souhaitable dans une économie de l’innovation, en dépit des préconisations de l’OMC, et que l’on peut déterminer un niveau de droit de douane optimal, et soutenir par des subventions les secteurs industriels innovants. Dans une « économie naissante » (pour élargir la célèbre notion d’industrie naissante de F. List au XIXème siècle), où le plus important est le soutien public à l’innovation, le protectionnisme (re)devient légitime.
Par ailleurs, les pays émergents, plutôt que d’appliquer les principes du « consensus de Washington » fondés sur l’ouverture et la libéralisation des systèmes productif, devraient au contraire miser sur les politiques industrielles permanentes (subventions notamment) en mesure de piloter le développement des entreprises dynamiques, afin de réduire l’écart du savoir, comme l’on fait intelligemment certains pays à l’instar de la Corée du Sud.
Mais Joseph E. Stiglitz et Bruce C. Greenwald s’attaquent également dans cet ouvrage aux stratégies de libéralisation financière imposées aux pays émergents par les institutions internationales (FMI, Banque mondiale) qui ont accru l’instabilité des marchés de capitaux et la cyclicité des économies, alors même que la promotion d’une économie de l’apprentissage nécessite une stabilité macroéconomique. Cette déréglementation financière a aussi entraîné une allocation défectueuse du capital peu propice à l’accumulation du savoir selon les auteurs, qui justifierait pleinement désormais de restaurer des réglementations financières publiques raisonnables sur les entrées et les sorties de capitaux. Les auteurs plaident aussi pour l’établissement d’un cadre juridique des droits de la propriété intellectuelle incitatif et encourageant l’innovation, mais suffisamment souple pour qu’il évite une culture du secret qui entraverait la transmission des connaissances. Ils soulignent que l’Etat a aussi un rôle déterminant à jouer en matière d’investissements publics et d’éducation, de soutien aux entreprises porteuses des innovations, et en termes de protection sociale pour assurer la stabilité macroéconomique et soutenir une croissance inclusive sur le long terme.
Cette croissance inclusive est d’autant plus importante pour Joseph E. Stiglitz et Bruce C. Greenwald, que l’inégalité est néfaste à l’apprentissage, et ils rappellent que « si l’on ne fait pas le nécessaire pour que tout le monde vive à hauteur de ses aptitudes, on gaspille la ressource la plus précieuse d’un pays : son talent humain ».
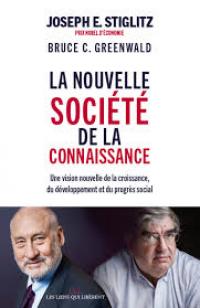
Quatrième de couverture
Construire une économie et une société capables d’apprendre, une « nouvelle société de la connaissance », indispensable à l’élévation de la prospérité de nos pays : tel est le défi relevé par les éminents économistes Joseph E. Stiglitz et Bruce Greenwald.
Dans cet ouvrage, les auteurs proposent un nouveau modèle, dit de « croissance endogène » : en partant du postulat que l’augmentation des revenus est en grande partie attribuable, non pas à l’accumulation du capital, mais au progrès technologique, c’est-à-dire à la capacité à apprendre à mieux faire. Comment les sociétés doivent apprendre ? Et surtout, comment les sociétés doivent apprendre à apprendre ?
Apprendre à organiser des collectivités d’individus, apprendre à mieux adapter les personnes aux emplois en analysant les avantages comparatifs, apprendre à se développer en sélectionnant les meilleurs entrepreneurs potentiels. Apprendre de notre pratique d’acquisition des savoirs mais également de celle des autres.
Autrement dit, comment faire évoluer alors notre système éducatif pour qu’il contribue à l’ouverture du savoir vital au développement des sociétés de demain ?
Un des points fondamentaux du livre est de démontrer que dans ces nouvelles sociétés du savoir et de la connaissance, les marchés laissés à eux-mêmes ne sont pas efficaces. Pire, ils favorisent une réelle stagnation. Aussi, à la doctrine néolibérale, les auteurs opposent la nécessité salvatrice de l’intervention publique : l’instauration d’un régime de propriété plus souple et de nouvelles politiques – industrielle, commerciale, d’investissement – alternatives.
Les auteurs
Joseph E. Stiglitz, lauréat du prix Nobel d'économie en 2001, ancien économiste en chef de la Banque mondiale, a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels « Le prix de l'inégalité » et « Le triomphe de la cupidité » (Editions Les Liens qui libèrent). Bruce C. Greenwald, également économiste, enseigne cette matière à l'université de Columbia. Le New York Times le considère comme le "gourou des gourous de Wall Street" et il est un des spécialistes de Kenneth Arrow les plus reconnus.