Mots-clés : développement durable – soutenabilité faible – soutenabilité faible – progrès technique – décroissance
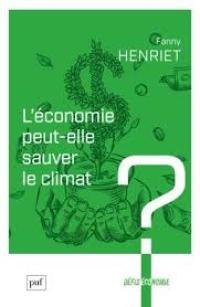
Résumé
Devant l’urgence écologique, on renvoie généralement dos-à-dos deux grandes options : l’optimisme écologique et le pessimisme décroissant. Avec cet ouvrage, Fanny Henriet montre qu’il faut sortir des dogmes idéologiques pour mettre en œuvre les meilleures idées permettant de décarboner nos économies.
L’ouvrage
L’autrice commence par souligner un paradoxe : alors que l’urgence climatique n’a jamais été aussi palpable (notamment par le biais des catastrophes naturelles), l’humanité semble incapable d’en prendre la mesure et de réagir de façon appropriée. La question est alors de savoir si l’économie est un atout (ou pas) pour trouver les « bonnes » réponses posées par le réchauffement climatique.
La formulation « l’économie » est volontairement vague car il s’agit de considérer deux dimensions en partie distincte : tout d’abord, « l’économie » comme modèle politique, soit le capitalisme libéral qui, depuis le début du XIXème siècle, est à la fois porteur d’une formidable hausse du niveau de vie et, en même temps, source de destruction de ressources naturelles (comme le montre G. Hardin dans « La tragédie des communs » dès 1968) et d’externalités négatives (à l’instar de la pollution) ; ensuite, « l’économie » comme discipline académique, soit une accumulation de savoirs qui doit nous aider à comprendre le rapport des hommes aux richesses, leur distribution, et qui propose des solutions correctrices (généralement étatiques) pour réparer les défaillances de l’économie de marché. Selon Fanny Henriet, trop souvent, on aurait tendance à confondre les deux perspectives. Or, si « l’économie » conçue comme système politique (autour du capitalisme libéral) ne peut pas « sauver le climat », ce n’est pas le cas de la science économique qui doit être mobilisée pour construire un modèle durable (y compris en s’appuyant sur le marché).
Voir la définition d’économie de marché
I- Le dilemme
Fanny Henriet commence par expliquer que l’humanité est confrontée à un redoutable dilemme : il est en effet impératif de sortir d’une économie fondée sur les énergies fossiles, mais à quel rythme ? Si la sortie est trop lente, les conséquences climatiques peuvent se montrer irréversibles et dévastatrices ; d’un autre côté, si la sortie est trop rapide, cette transition risque de provoquer des chocs économiques et sociaux particulièrement douloureux. « L’enjeu, dès lors, est de trouver un équilibre délicat entre des sacrifices immédiats et des dommages à long terme que nous cherchons à éviter » indique l’autrice.
L’ambition est élevée : il s’agit d’en arriver à un monde à zéro émission nette (ce qui revient à atteindre un point où les émissions de gaz à effet de serre soient compensées par leur absorption, tant par des puits naturels – comme les océans et les forêts – que par de nouvelles capacités de capture et de stockage du carbone), et ce, afin de stabiliser la température.
En pratique, 87 % des émissions anthropiques de CO2 proviennent de la combustion d’énergie fossiles, ce qui semble plaider pour leur interdiction. Mais, contrairement à ce qui été possible avec les gaz CFC dans le cadre du protocole de Montréal (1987) pour protéger la couche d’ozone, il n’existe pas encore d’alternatives peu couteuses et prêtes à être déployées. Interdire la pollution thermique conduirait inévitablement à une perturbation majeure tant sur le plan économique (comment produire sans cette énergie ?) que social (transports, chauffage, électricité etc.), au point qu’elle pourrait même s’estimer comme potentiellement plus dangereuse que les effets du changement climatique lui-même.
Il faut donc opter pour une réduction graduelle de l’usage des énergies fossiles, moins couteuse (à court terme) pour la population et les entreprises, mais cette solution nous ramène au dilemme évoquer plus haut : ou placer le curseur ? Une action trop lente – comme celle que nous connaissons actuellement à l’échelle mondiale – ne suffira pas à endiguer de manière décisive le réchauffement climatique. Nombreuses sur le sujet, les études empiriques sont formelles. Mais, d’un autre côté, une action trop rapide conduirait à des dommages économiques et sociaux que l’on souhaiterait éviter, à l’image de l’augmentation des inégalités provoquée par une taxe carbone uniforme sur l’essence (cf. conflit des « Gilets jaunes » en 2018-2019). On ramène souvent ce dilemme à une question : faut-il privilégier la « fin du mois » ou tout faire pour éviter la « fin du monde » ?
Pour approcher une réponse « raisonnable », on peut se servir de la discipline « économie » qui propose généralement de procéder à un calcul coût/avantage. Une forte réduction des gaz à effet de serre conduit à distinguer les sacrifices économiques immédiats (baisse de l’activité économique, investissements très chers etc.) aux bénéfices futurs (très élevés mais qui sont pondérés par leur difficulté à être quantifiés et leurs effets lointains – obligeant à chiffrer un hypothétique taux d’actualisation). William Nordhaus est l’un des premiers à avoir appliquer ce type de méthode (il reçoit d’ailleurs le Prix Nobel d’économie en 2018 pour ses travaux d’économie environnementale) mais il aboutit à un résultat très surprenant aujourd’hui : le réchauffement climatique « optimal » serait de 4° C d’ici la fin du siècle. Au cours de son raisonnement, l’économiste américain a tout simplement sous-estimé les dégâts potentiels du réchauffement climatique (le taux d’actualisation choisit était trop élevé).
Fanny Henriet explique qu’un tel calcul ne serait plus possible aujourd’hui car la notion de « cout social du carbone » a émergé de façon à chiffer de façon plus précise les dommages causés par chaque tonne de CO2 émise aujourd’hui. L’économie permet ici de traduire, sous une forme monétaire, les impacts économiques et sociaux provoqués par l’ajout de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Dans de nombreux pays, cette mesure du « cout social du carbone » est utilisée pour guider les politiques publiques. Aux Etats-Unis, on peut observer que le chiffre ne cesse de progresser (jusqu’à l’arrivée de Donald Trump lors de son premier mandat), non seulement parce qu’on a une meilleure connaissance des dommages causés par le changement climatique mais aussi parce que le taux d’actualisation retenu est désormais plus faible (les dégâts futurs sont davantage pris en compte).
Dès lors, est-il désormais possible de déterminer si une politique climatique est économiquement justifiée. Si le coût par tonne de CO2 qu’elle permet d’éviter est inférieur au « cout social du carbone », l’action des pouvoirs publics est « profitable » …
Voir la note de lecture du livre de William Nordhaus : Le casino climatique (2019)
II- Décroissance ou techno optimisme ?
Les émissions de CO2 sont encore fortement corrélées avec le PIB (notamment à l’échelle mondiale). Faut-il alors envisager la décroissance ? Fanny Henriet explique qu’il n’y a pas de doute que, d’un point de vue quantitatif, la décroissance permettrait de nous rapprocher de nos objectifs climatiques. Mais a-t-on conscience de ce que cela signifierait sur le plan qualitatif ? L’autrice examine alors la deuxième solution, quasiment diamétralement opposée, du techno-solutionnisme : approche résolument optimiste, cette vision du monde est dotée d’une foi inébranlable dans la capacité des hommes à « se sauver ». Comment ? Par le progrès technique et la croissance économique verte.
Alors, faut-il compter sur le progrès technique pour « décarboner » l’économie sans renoncer à la croissance ? Ou bien devons-nous envisager une forme de décroissance « contrainte » (par opposition à la sobriété « volontaire ») pour réellement inverser la tendance ?
Le choix de la décroissance a le vent en poupe, défendu notamment par Timothée Parrique (Ralentir ou périr. L’économie de la décroissance, 2022), parce que la croissance verte donne – pour l’instant – des résultats très décevants. Après calculs, Fanny Henriet estime néanmoins que la croissance économique nécessaire pour un pays comme la France supposerait d’en revenir au PIB... de 1960 ! Et si l’on tenait compte de l’augmentation de la population depuis cette date, il faudrait « descendre » au PIB de 1950. Une telle décroissance généralisée parait très difficilement acceptable pour les pays développés – pour ne pas écrire « impossible » à accepter – puisque ce serait nécessairement revenir sur des progrès en matière de niveau de vie, d’espérance de vie (santé publique) et d’éducation. Et la question se pose-t-elle avec une acuité encore plus forte pour les pays en développement.
Si la croissance économique n’est pas parfaite, elle permet d’élever le niveau de vie, d’améliorer le mode de vie et donne les moyens de lutter contre les inégalités (si les choix politiques vont dans ce sens) ; aussi, peut-on se demander s’il est possible de lutter contre le réchauffement climatique sans diminuer le PIB ?
C’est la voie ouverte par les partisans de la soutenabilité faible (Nordhaus, Solow) qui croient au découplage entre émission de CO2 et croissance économique. De fait, force est de constater que des pays comme les nations scandinaves ou encore l’Angleterre connaissent un net découplage absolu (le PIB augmente tandis que les émissions de CO2 diminuent). Pour autant, il convient de rester prudent car les premières étapes de décarbonation sont les plus faciles (à l’image de l’Angleterre qui a commencé par fermer ses mines de charbon… très polluantes). Ensuite, le processus de transition énergétique devient plus complexe et difficile à mettre en œuvre. De son côté, la France amorce un découplage absolu, principalement en raison de l’amélioration de l’efficacité énergétique (un autre facteur conséquent renvoie à la désindustrialisation, mais faut-il s’en réjouir ?). Pour autant, l’effort est-il suffisant ? Pour atteindre l’objectif de neutralité carbone en 2050, il faudrait que la France réduise ses émissions de CO2 de 75 à 80 % ; or, si l’on reste sur la trajectoire actuelle, elle n’obtiendra qu’une baisse de… 20 %.
Par ailleurs, des pays très polluants, comme la Chine, n’en sont qu’à un découplage relatif (les émissions de CO2 augmentent moins vite que le PIB).
Il est alors tentant de penser que le progrès technique est un moyen d’accélérer la transition écologique sans (trop) renoncer au système économique qui a permis d’améliorer nos niveaux de vie. Fanny Henriet se montre très sceptique, en raison notamment de l’effet rebond associé au progrès technique. D’abord mis en évidence par Stanley Jevons à propos de l’utilisation du charbon au cours de la révolution industrielle, on observe toujours aujourd’hui que les améliorations technologiques finissent par élever le niveau global de pollution et/ou d’extraction des ressources naturelles. Une plus grande efficacité énergétique provoquée par le progrès technique se traduit par une baisse des prix, ce qui se traduit par une utilisation plus intensive de ces technologies et ne permet pas de conserver les bénéfices environnementaux espérés….
Voir la note de lecture du livre de Timothée Parrique : Ralentir ou périr (2022)
Voir les principales définitions autour de « La soutenabilité de la croissance et du développement » :
III- Inciter et planifier
Pour parvenir à atteindre les objectifs climatiques, il est impératif de modifier les normes sociales – de façon à obtenir une sobriété volontaire (plutôt qu’imposée) ; mais il parait également absolument indispensable d’utiliser des politiques économiques qui incitent/voire contraignent à adopter les bons comportements (individuels et collectifs). Seule une stratégie mixte permet d’envisager d’atteindre la neutralité carbone dans un délai satisfaisant.
Les avancées technologiques sont nécessaires pour progressivement parvenir à une décarbonation massive de la production d’électricité (et arriver à produire de l’électricité sans émettre de gaz à effet de serre par le biais du nucléaire et/ou des énergies renouvelables), rendre possible une électrification des usages dans les secteurs clés (comme les transports et l’industrie) tout en continuant d’améliorer l’efficacité énergétique.
Mais à ces solutions techniques, doit nécessairement s’ajouter un volet sobriété : la réduction de certaines consommations et la lutte contre l’effet rebond sont cruciaux pour réduire la demande énergétique.
« Cette synergie entre innovation technique et ajustement des comportements constitue la clé d’une transition vers une économie bas carbone » ajoute Fanny Henriet.
Pour activer ces leviers, l’autrice montre tout d’abord qu’il faut jouer sur les incitations économiques (plutôt que sur une norme d’interdiction) : avec une taxe carbone, le coût supplémentaire à la pollution est directement corrélé avec la quantité de CO2 émise – même s’il faut prévenir les effets redistributifs ; les marchés d’échange de quota d’émission sont également très efficaces pour inciter les entreprises à modifier leur processus de production dans un sens plus conforme à la protection de l’environnement. Mais là encore, ces mesures ne sauraient suffire : une planification rigoureuse est incontournable pour être certain que l’effort est réparti de manière juste et soutenable ou encore pour s’assurer de réunir les fonds (très importants) nécessaires aux investissements écologiques. Dans un contexte de sensibilité accrue vis-à-vis des inégalités et de tension sur les finances publiques, il devient très imprudent de ne pas mener une véritable planification de la transition écologique. D’autant que cet ouvrage se focalise sur la question du climat alors que Fanny Henriet prend bien soin de préciser, à la toute fin de sa conclusion, que « le défi est global ; il ne s’agit pas de simplement sauver le climat, mais de préserver l’intégrité de notre environnement dans son ensemble ».
Voir la vidéo « Transition environnementale : Comment accélérer (vraiment) la transition écologique des entreprises ? » :
Voir la vidéo et d'autres ressources
L’auteur
Fanny Henriet est directrice de recherche au CNRS à l’Ecole d’économie d’Aix-Marseille et enseignante à l’Ecole polytechnique. Médaille de bronze du CNRS 2023, elle a été nommée au prix du meilleur jeune économiste en 2024.
Quatrième de couverture
L’urgence d’agir face au changement climatique n’a jamais été aussi pressante. Les coûts liés à ces perturbations sont extrêmement élevés : baisse des rendements agricoles, effets sur la santé des populations, perte de la biodiversité… Contribuant à l’amélioration de notre niveau de vie, l’économie est aussi responsable de l’augmentation incontrôlée des émissions de gaz à effet de serre.
Source du problème, notre système économique est-il capable de répondre efficacement à l’urgence climatique ?
Fanny Henriet invite à prendre en compte les différentes solutions possibles : décroissance, progrès technique, sobriété. Elle insiste sur la nécessité de dépasser les seules responsabilités individuelles pour engager une politique publique ambitieuse, capable de mobiliser les États comme les entreprises.




