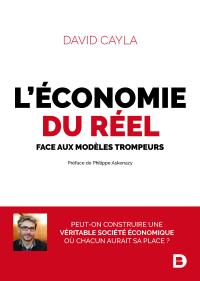L'ouvrage
Dans cet essai, David Cayla, membre du collectif des « Economistes atterrés », développe une critique hétérodoxe de la science économique actuelle, trop prompte selon lui à énoncer des vérités et des certitudes sur la base de modèles théoriques à la légitimité qu’il estime discutable, et qui servent ensuite à orienter les politiques économiques dans un sens idéologiquement biaisé. En effet, pour lui, « en économie les représentations ne sont pas neutres. Et nous ne pouvons que constater que lorsqu’elles sont fausses, elles poussent ceux qui les adoptent à proposer de mauvaises politiques économiques dont les conséquences peuvent désastreuses ». Il regrette notamment que « la plupart des économistes prétendent étudier une économie « pure » détachée des autres sciences sociales ». C’est la raison pour laquelle il plaide dans cet ouvrage pour que la recherche en économie s’enrichisse d’un dialogue fécond avec les autres sciences sociales (anthropologie, histoire, science politique, sociologie) pour comprendre les interactions entre les logiques marchandes et les institutions sociales (« les forces sociales et économiques sont indéfectiblement liées ») et mieux déchiffrer le capitalisme. Il s’appuie au début de son ouvrage sur l’exemple du marché de l’immobilier du centre-ville de Paris pour décrire la dynamique des prix, sur lequel l’évolution des prix du logement est davantage déterminée par l’accumulation patrimoniale de ceux qui possèdent déjà des biens, que par ceux qui travaillent et produisent des richesses, avec des implications sociales et politiques importantes sur la ségrégation territoriale et la composition sociale des quartiers, donc sur la cohésion sociale. David Cayla estime même que la science économique est aujourd’hui une discipline « dévitalisée », repliée sur elle-même, qui a besoin de compléter ses modélisations par des connaissances non exclusivement économiques.
Les présupposés normatifs de l’économie
En partant des défaillances du marché et de leurs conséquences très préoccupantes sur l’environnement, et du constat d’échec de certains dispositifs comme celui du marché du carbone européen, l’auteur défend l’idée qu’il faut davantage s’interroger sur le modèle de la théorie économique standard, selon lequel les mécanismes d’incitation et d’internalisation des externalités sont supposés plus efficaces que les réglementations. En effet, les économistes considèrent généralement que toute réglementation publique est censée générer des détournements et des rentes au profit des lobbies, alors qu’à l’inverse, un marché, pourvu qu’il soit concurrentiel, est nécessairement efficace et bon pour la population. Or David Cayla en conteste l’idée : selon lui il n’existe pas de travaux robustes et de validation empirique qui prouverait la supériorité de la régulation par le marché sur l’intervention publique.
En s’appuyant sur l’exemple de la pénurie de beurre qui a sévi en octobre 2017, il estime que les lois de l’offre et de la demande décrites dans les manuels d’économie ont été inopérantes : la théorie économique considère séparément le marché du beurre et celui du lait, qui répondent à deux demandes différentes…alors que l’on ne peut simplement pas produire du beurre sans produire du lait. Dès lors, l’offre ne s’ajuste pas à la demande et le modèle ne parvient pas à comprendre les interactions entre les différents marchés, ainsi que la pénurie qui peut perdurer (la baisse du prix du lait sur les marchés ne compense pas la hausse du prix du beurre) sans force de rappel garantissant un retour vers le prix d’équilibre. Pour David Cayla, « contrairement aux conclusions rassurantes du modèle théorique qui voit le prix du marché graviter sereinement autour d’un point d’équilibre, les marchés agricoles réels sont instables et imprévisibles…et de ce fait, incapables de fournir des incitations valides aux producteurs ». Selon lui, la stratégie adoptée par les autorités européennes et généralement chaudement recommandée par les économistes (il cite le Prix Nobel d’économie français Jean Tirole), fondée sur l’idée d’une préférence pour les capacités autorégulatrices des marchés, a engendré en réalité une volatilité plus grande des prix agricoles et une déstabilisation du système productif agricole.
David Cayla fait valoir que les économistes postulent un marché parfait réputé efficace qui sert bien souvent d’idéal vers lequel il faudrait tendre : dans cette conception, le rôle de l’économiste est moins d’expliquer les phénomènes observés que de construire un modèle à partir duquel on pourra agir sur le réel. Alors que la véritable démarche scientifique est avant tout positive, en cherchant à décrire le réel tel qu’il se présente, dans toute sa complexité ou avec des simplifications raisonnables, la très grande majorité des économistes contemporain adopte au contraire une méthode normative : « ils cherchent d’abord à établir un modèle de référence qualifié d’optimal, afin ensuite d’appréhender le réel et, autant que possible, de proposer des recommandations pour adapter la réalité à la théorie ». Or l’idée que le marché est spontanément synonyme d’efficacité, en vertu de la métaphore de la « main invisible » et de l’harmonie naturelle des intérêts évoquée en 1776 par Adam Smith, s’avère discutable selon l’auteur : elle conduit surtout à une fascination pour le modèle abstrait de concurrence pure et parfaite. La démarche qui par de l’abstrait, donc de l’idéal, en posant d’abord le modèle, pour aller vers le réel nécessairement imparfait, constitue une faille importante de la réflexion économique : elle conduit à ne plus s’interroger sur la validité du modèle théorique (« Comment peut-on comprendre le marché du lait à partir d’un simple modèle offre/demande qui évacue la complémentarité entre les productions de beurre et de lait, qui n’intègre pas les différentes manières d’élever des vaches (sur pâturage ou dans les hangars), qui ne prend pas en compte la volatilité des prix des céréales, ni celle de la viande de bœuf, qui ne dit rien des réformes institutionnelles de la PAC, qui laisse de côté les effets de la concurrence internationale, qui évacue les systèmes de négociations complexes entre éleveurs, transformateurs et distributeurs, qui n’analyse pas les conséquences de la concentration des exploitations, qui ne dit rien de la manière dont les agriculteurs s’adaptent (ou non) à un environnement qui ne cesse de se transformer ? »)
Par ailleurs David Cayla regrette dans ces pages que la science économique moderne ait perdu le lien avec la « science de la richesse » des pères fondateurs de l’économie politique (Smith, Ricardo, Marx…) pour glisser vers « la science des choix » en situation de ressources rares, au nom de l’individualisme méthodologique et de la démarche réductionniste basée sur le comportement de l’homo oeconomicus. Il considère pour sa part que la science économique a progressivement été aveuglée par le mythe de la « main invisible » et a pensé que l’on pouvait, pour consolider sa scientificité, modéliser l’ensemble de l’économie à partir de mécanismes de marché extrêmement simples qui sont censés spontanément engendrer une économie performante.
Lire la note de lecture de l’ouvrage de Dani Rodrik sur le rôle des économistes dans la Cité :
La portée sociale et politique des modèles
Selon David Cayla le règne sans partage de la théorie néoclassique dans la science économique moderne, au détriment des autres courants de pensée en économie, empêche d’apporter certains éclairages qui pourraient être pertinents, et même « finit par enfermer les économistes dans une bulle dogmatique mortifère ». Plus grave, selon lui, la théorie néoclassique, comme jadis d’autres courants de pensée l’ont fait, à l’instar de l’école physiocratique qui a légitimé dans ses raisonnements la classe sociale des propriétaires fonciers et le produit net des agriculteurs comme créateurs de richesse, véhicule une certaine conception du monde, celle de « l’idéologie du marché » comme unique référence, et comme ordre naturel de l’économie. Il estime notamment que la vision de la concurrence du modèle néoclassique, en termes de statique comparative et d’équilibre, ne permet guère de comprendre la dynamique de transformation que la compétition sur les marchés et la stratégie des entreprises engendre. Par ailleurs, il critique le modèle d’équilibre général de Walras comme idéal purement théorique bien trop éloigné des marchés réels : cette référence intellectuelle des économistes suppose la centralisation des offres et des demandes, nie les effets d’interdépendance entre ces dernières (par exemple les variations des prix d’une marchandise qui ne peuvent à elles seules expliquer la demande), et évacue les problèmes liés à l’agrégation des offres et des demandes individuelles. Avec ce type de modèle imparfait, qui devrait inciter à la modestie, d’ailleurs entouré d’un ensemble d’hypothèses restrictives par les économistes l’ayant approfondi (comme Sonnenschein, Mantel, Arrow, Debreu), il estime qu’il est bien difficile, dans la réalité, de déterminer des prix justes et une allocation optimale des ressources sans intervention publique. Pourtant il fait valoir que les institutions européennes ont choisi ce modèle néoclassique comme référence pour préférer une politique de la concurrence à une politique industrielle plus volontariste, ou faire le choix du libre-échange dans le domaine commercial. Or, en fonction des études disponibles, rien ne prouve selon lui que la pression concurrentielle a permis sur le marché européen (et sur l’ensemble des secteurs concernés par la libéralisation qui ont chacun leurs spécificités), de faire baisser les prix et de stimuler l’innovation. Il cite également l’hypothèse de la loi des rendements décroissants présupposée par de nombreux manuels d’économie : pourtant si on accepte de raisonner en présence de rendements croissants et de sortir de la courbe d’offre traditionnelle, les résultats deviennent extrêmement différents. Il estime aussi que la prégnance de l’idée d’autorégulation des marchés peut conduire à délégitimer la politique de stabilisation macroéconomique, alors que les évènements comme la crise de 2007-2008 ont montré qu’ils restent indispensables lorsque les anticipations mimétiques sur les marchés financiers et le cycle du crédit exercent leurs effets.
Enfin, en citant les travaux de Karl Polanyi, David Cayla estime que la normativité de la théorie néoclassique comme seule grille de lecture de l’économie présente le risque d’instaurer ce qu’il appelle une « société de marché », lorsque l’idéologie du marché façonne toute l’organisation sociale. Ce modèle de société implicitement véhiculé par la théorie des marchés nierait alors tout simplement l’existence de la société, dans toute la richesse de ses liens, avec les structures familiales, les relations amicales et amoureuses, le don et le contre/don dans les relations sociales, la gratuité, l’altruisme, ou le rôle du substrat culturel et des traditions, pour imposer une anthropologie unique (à ses yeux discutable) de l’homme économique rationnel, simple calculateur de ses plaisirs et de ses peines, celui qui est présent dans les manuels d’économie universitaire. Dans la fin de son ouvrage, il donne ainsi à l’appui de sa thèse l’exemple des réformes du marché du travail : si l’on conçoit le travail comme une simple marchandise échangeable à une certaine valeur économique, dans le cadre d’une logique d’équilibre sur un marché théorique, on oublie que la société a développé historiquement des protections collectives pour éviter les effets les plus brutaux de la concurrence afin de préserver la dignité des personnes.
Voir la vidéo de l’économiste André Orléan sur la théorie de la valeur :
L'auteur
-
David Cayla est économiste à l’université d’Angers. Originaire de la région grenobloise, il étudie l’épistémologie et l’histoire de la pensée économique à l’université Paris 1, puis obtient un doctorat d’économie en 2007. Défenseur d’une économie hétérodoxe ouverte aux autres sciences sociales, il rejoint en 2013 le collectif des Économistes atterré. Il est l’auteur, avec l’essayiste Coralie Delaume de La fin de l’Union européenne (Michalon, 2017).