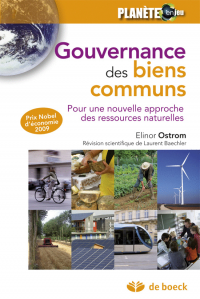L’ouvrage
Plus que jamais, la question de la bonne gestion des ressources naturelles apparaît comme un enjeu majeur pour les sociétés contemporaines. Cependant, lorsqu’il s’agit de déterminer le meilleur moyen pour limiter l’utilisation de ces ressources naturelles, les opinions divergent et les partisans respectifs des deux modes de régulation classique – centralisée (par l’Etat) ou décentralisée (par le marché) – s’opposent parfois farouchement. Ce débat politique est également transposé au niveau de la recherche. Certains articles préconisent un contrôle par l’Etat des ressources naturelles afin d’éviter leur destruction tandis que d’autres affirment que c’est la privatisation de ces ressources qui résoudra le problème. Pourtant, bien souvent, ce que l’on observe dans le monde, c’est que ni l’Etat, ni le marché, ne permettent une utilisation productive optimale à long terme des ressources naturelles. Il apparaît, dans bon nombre de cas, que les communautés ou les individus confient à des collectivités qui ne s’identifient ni à l’Etat, ni au marché, le soin de gouverner les systèmes de ressources naturelles sur de longues périodes de temps, avec des degrés de réussite divers. Le livre d’Ostrom vise à critiquer les fondements des politiques appliquées à de nombreuses ressources naturelles en s’appuyant sur divers exemples de gouvernance et de gestion de ces ressources et en cherchant à déterminer les compétences et les limites des collectivités autonomes pour la régulation de celles-ci. A cette fin, l’ouvrage décrit d’abord les trois modèles les plus fréquemment utilisés pour fournir un fondement à la recommandation de solutions étatiques ou de marché, avant de proposer une alternative. En utilisant un mode d’analyse institutionnel, il tente d’expliquer comment les communautés et les individus façonnent les différentes manières de gouverner les biens communs.
Trois modèles de base pour appréhender les biens communs
La tragédie des biens communs. Depuis l’article fondateur de Garett Hardin en 1968 (« The Tragedy of Commons », Science 162 : 1243-1248), la notion de « tragédie des biens communs » symbolise la dégradation de l’environnement à laquelle il faut s’attendre dès lors que plusieurs individus utilisent en commun une ressource limitée. Pour illustrer cette notion, Hardin suggère de se représenter un pâturage en accès libre. Si l’on est dans le contexte où chaque éleveur retire un bénéfice direct de ses animaux et supporte les coûts différés de la détérioration du bien commun causée par le surpâturage, leur stratégie sera d’ajouter de plus en plus d’animaux, car ils perçoivent la totalité du bénéfice lié à la vente de leurs bêtes alors qu’ils ne supportent qu’une partie des coûts engendrés par ce surpâturage. La tragédie, conclut Hardin, réside dans le fait que lorsque chacun poursuit son intérêt dans une société qui croit en la liberté des biens communs, la ruine de tous est la destination vers laquelle les hommes se ruent immanquablement. Cette tragédie des biens communs était d’ailleurs reconnue depuis fort longtemps. Aristote dans La Politique (Livre II, chapitre 3) observe que « ce qui est commun au plus grand nombre fait l’objet des soins les moins attentifs. L’homme prend le plus grand soin de ce qui lui est propre, il a tendance à négliger ce qui lui est commun ». Au cours du XXème siècle, elle a été prise comme modèle pour expliquer des problèmes aussi divers que la famine sahélienne des années 1970, les pluies acides, l’organisation de l’Eglise mormone, l’incapacité du Congrès des Etats-Unis à limiter ses dépenses ou encore la criminalité urbaine.
Le jeu du dilemme du prisonnier. Le modèle de Hardin a été formalisé par le jeu du dilemme du prisonnier. Supposons que les joueurs soient des éleveurs utilisant une prairie en commun. Le nombre maximum d’animaux pouvant paître dans cette prairie tout en étant bien nourris est L. Dans un jeu à deux acteurs, la stratégie coopérative se traduit par le pâturage d’un nombre L/2 d’animaux pour chaque éleveur. La stratégie de défection consiste à faire paître le nombre d’animaux que l’on pense pouvoir vendre, en supposant que ce nombre soit supérieur à L/2. Si les deux éleveurs coopèrent, ils obtiennent 10 unités de profit, et s’ils optent tous deux pour la défection, leurs profits seront nuls. Si l’un coopère alors que l’autre fait défection, le « défectionnaire » obtient 11 unités de profit et le « coopérateur »-1. Si tous les deux choisissent indépendamment, l’optimum de Pareto ne se réalise pas, et c’est la stratégie de défection qui l’emporte. Ce jeu montre que des stratégies rationnelles sur un plan individuel peuvent conduire à un résultat irrationnel au niveau collectif.
La logique de l’action collective. Dans La logique de l’action collective (1965), Mancur Olson remet en question l’idée selon laquelle la possibilité d’un bénéfice pour un groupe suffirait à générer une action collective dans le but de réaliser ce bénéfice. Puisqu’un individu ne peut généralement pas être exclu de la jouissance des bénéfices du bien collectif, il n’est guère incité à contribuer volontairement à la fourniture de ce bien (comportement de passager clandestin).
Les prescriptions politiques issues des modèles… et leur alternative
Le Léviathan comme seul moyen. Selon Ophuls (“Leviathan or Oblivion”, in Toward a Steady State Economy, ed. H.E. Daily, pp 215-230, San Francisco, Freeman, 1973), « à cause de la tragédie des biens communs, les problèmes environnementaux ne peuvent être résolus par la coopération, et si nous évitons cette tragédie, ce ne sera dû qu’à la tragique nécessité du Léviathan ». La supposition qu’un Léviathan externe est nécessaire pour éviter la tragédie des biens communs conduit à des recommandations prônant un contrôle de la plupart des systèmes de ressources naturelles par des gouvernements centraux. Pour Heilbroner (An Inquiry Into the Human Prospect, New York, Norton, 1974), des « gouvernements de fer », peut-être même des régimes militaires, seraient nécessaires pour lutter contre les problèmes environnementaux. Pour que la recommandation de centraliser le contrôle aboutisse à un équilibre optimal, il faut toutefois que l’information reçue soit complète et pertinente et qu’il existe des capacités de surveillance, des sanctions dissuasives et de coûts de gestion maîtrisés. Sans une information valable et fiable, une agence centrale peut commettre de nombreuses erreurs, par exemple en fixant des amendes trop élevées ou trop faibles, en sanctionnant les producteurs qui coopèrent ou en ne sanctionnant pas les resquilleurs (problèmes d’information incomplète).
La privatisation comme seul moyen. Pour Robert Smith (« Resolving the Tragedy of the Commons by Creating Private Property Rights in Wildlife », Cato Journal 1, pp 439-468, 1981), « le seul moyen d’éviter la tragédie des biens communs aux ressources naturelles et à la biodiversité est de mettre un terme au système de la propriété commune en instaurant un système de droits de propriété privée ». Il est cependant difficile de savoir ce que sous-entendent exactement les analystes lorsqu’ils font allusion à la nécessité de développer des droits privés sur certaines ressources communes. Lorsqu’il s’agit de la terre, la chose est simple, puisqu’il suffit de la diviser en parcelles séparées, mais lorsqu’il s’agit de ressources dites « non stationnaires », comme l’eau ou la pêche, la signification d’un établissement de droits privés est plus floue. Colin Clark a d’ailleurs souligné à ce sujet (“Restricted Access to Common–Property Fischery Resources : A Game-Theoretic Analysis”, in Dynamic Optimization and Mathematical Economics, ed. P.T. Liu, pp 117-132, New York, Plenum Press, 1980) que « la tragédie des biens communs s’avère particulièrement difficile à contrer dans le cas des ressources de pêches marines, où l’établissement de droits de propriété individuels est virtuellement irréalisable ».
L’alternative. Un point commun entre les partisans de la centralisation et les partisans de la privatisation est qu’ils acceptent comme principe central que les changements institutionnels doivent venir de l’extérieur et être imposés aux individus concernés. Or, plutôt que de partir du principe que les individus qui partagent un bien commun sont inéluctablement pris dans un piège dont ils ne peuvent s’échapper, Ostrom postule que la capacité de ces individus à se tirer des différents types de dilemme varie de situation en situation. Plutôt que de faire reposer les politiques sur la présomption que les acteurs concernés sont impuissants, l’auteur de Gouvernance des biens communs préfère s’intéresser à l’expérience d’individus confrontés à des situations réelles. Pourquoi certains efforts de résolution des problèmes liés à des biens communs échouent-ils alors que d’autres réussissent ? Quels enseignements pouvons-nous tirer de l’expérience pour stimuler le développement et l’utilisation d’une meilleure théorie de l’action collective ? De fait, les institutions sont rarement soit privées, soit publiques, et de nombreuses institutions actives dans la gestion des ressources communes relèvent à la fois de l’une et l’autre des deux sphères et remettent ainsi en cause toute classification procédant d’une dichotomie stérile. Sur le terrain en effet, les institutions publiques et privées s’articulent les unes aux autres et dépendent les unes des autres au lieu d’évoluer dans des mondes distincts.
Les cadres de l’analyse institutionnelle
Les études utilisées et leur philosophie. Ostrom se propose d’étudier les « institutions », qu’elle définit comme « des ensembles de règles opérationnelles utilisées pour déterminer ce qui est éligible pour prendre des décisions dans une certaine arène, quelles actions sont permises et prohibées, quelles règles d’action seront utilisées, quelles procédures seront suivies, quelle information doit ou ne doit pas être fournie et quels gains seront attribués aux individus en fonction de leurs activités (« A Method of Institutional Analysis », in Guidance, Control and Evaluation in the Public Sector, ed. F.X Kaufman, G. Majonc, V.Ostrom, pp 459-475, New York, Walter de Gruyter, 1980). Les règles opérationnelles sont celles qui sont réellement utilisées et dont l’application fait l’objet d’une surveillance lorsque les individus font des choix sur les actions qu’ils se proposent d’entreprendre. Elles relèvent d’une connaissance commune (chaque participant connaît les règles), font l’objet d’une surveillance et sont appliquées. C’est ce caractère opérationnel qui les différencie des règles de droit formelles qui figurent dans la législation, les réglementations administratives et les décisions de justice. Cela n’empêche évidemment pas ces règles d’être une source majeure des règles opérationnelles dans de nombreuses situations.
Les nombreux cas présentés par Ostrom concernent les systèmes de gestion des prairies et des forêts, de l’eau, des pêcheries, un peu partout dans le monde. Comme elle le souligne, ces cas sont issus d’univers de ressources communes de relativement petite échelle (la plus grande impliquant 15000 appropriateurs), chaque univers étant localisé dans un seul pays. Il s’agit donc d’environnements localisés dans lesquels les individus communiquent et interagissent de manière répétée. Il leur est possible d’apprendre à qui se fier, quels effets leurs actions auront sur les autres appropriateurs et la ressource gérée en commun, et comment s’organiser pour générer des bénéfices et limiter les préjudices. Dans ces situations, les individus possèdent un capital social qui les aide à mettre en place des dispositifs institutionnels pour résoudre leurs problèmes de ressources communes. Ils se différencient des trois modèles décrits plus haut qui sont plutôt utiles pour prédire les comportements dans le cadre de ressources communes de grande échelle dans lesquelles personne ne communique, chacun agit de manière indépendante, aucune attention n’est accordée aux effets des actions des différents acteurs et le coût de toute tentative pour changer la structure de la situation se révèle élevé. Pour Ostrom, il est très important que chacun comprenne que l’on ne tire pas les mêmes enseignements des systèmes de ressources naturelles à petite échelle et à grande échelle. Ainsi, les politiques publiques reposant sur l’hypothèse que, quelque soit l’environnement, les appropriateurs de ressources communes sont impuissants, conduisent à des erreurs redoutables et peuvent même parfois détruire le capital institutionnel acquis pendant des années d’expérience dans des lieux particuliers (comme c’est le cas des pêcheries écossaises). Si l’on se limite aux systèmes de ressources à petite échelle, l’objectif affiché par Ostrom est de parvenir à des développements théoriques permettant d’identifier les variables qui doivent être incluses dans tout effort tendant à expliquer et à prévoir dans quels cas des appropriateurs seront les mieux à même de s’auto-organiser et de gouverner efficacement les ressources dont ils disposent.
Quelques enseignements importants. Pour que des appropriateurs se dotent de nouvelles règles, et modifient grâce à ces règles le comportement de chacun, le système proposé doit présenter quelques caractéristiques importantes : les règles doivent définir l’ensemble des appropriateurs autorisés à utiliser une ressource commune, se rapporter aux attributs spécifiques de la ressource, être élaborées par les appropriateurs locaux, voir leur application surveillée par des individus qui rendent des comptes aux appropriateurs locaux et être accompagnées de sanctions graduelles. Dès lors que des individus se voient proposer des règles répondant à ces critères, un engagement sûr et avantageux peut être consenti. L’engagement est avantageux car si la plupart des individus le suivent, leur situation s’en trouve améliorée par rapport à ce qu’elle serait s’ils avaient opté pour des stratégies dominantes de court terme. L’engagement est sûr en ce sens que les individus qui le respectent ne peuvent être exploités par d’autres individus qui rompraient leurs engagements (à cause des sanctions graduelles).
Un autre enseignement est relatif aux variables affectant le jugement humain dans le calcul coût/bénéfice des changements institutionnels. Alors que la théorie de l’action collective met souvent l’accent sur l’analyse des variables internes à la situation (nombre de décideurs, nombre de participants minimal nécessaire pour réaliser les bénéfices collectifs, similitude des intérêts, présence de certains participants dotés d’un fort leadership), Ostrom met l’accent sur les coûts et bénéfices des changements institutionnels tels qu’ils sont perçus par les acteurs locaux. Les individus accordent par exemple une attention plus importante aux pertes potentielles qu’aux gains potentiels. Par conséquent, ils prendront davantage en compte les options consistant à éviter de futurs inconvénients que les bénéfices de la production de biens futurs (c’est la raison pour laquelle les leaders politiques envisagent souvent les problèmes de ressources communes en termes de « crises »). S’agissant des coûts, les individus sont aussi davantage disposés à adopter de nouvelles règles pour régir leurs activités d’appropriation quand il existe des indicateurs clairs de la dégradation d’une ressource (signes fiables de préjudices futurs). En outre, on constate aussi que tous les appropriateurs consacrent plus d’attention aux coûts immédiats qu’aux bénéfices qui s’échelonnent dans le futur, ce qui a pour conséquence qu’ils ne financeront pas des coûts de transformation pour modifier les règles s’ils s’attendent à ce que les bénéfices nets actualisés d’un tel changement soient relativement peu importants.
De manière plus générale, et si on laisse de côté les éventuelles interventions externes d’une autorité politique, Ostrom dégage les conditions essentielles à respecter pour l’adoption d’un changement institutionnel :
- les appropriateurs doivent partager le jugement commun qu’ils subiront un préjudice s’ils n’adoptent pas une règle alternative,
- ils doivent affectés de manière similaire par les changements de règles proposés,
- ils doivent accorder une grande importance à la poursuite de leur activité,
- le groupe des appropriateurs doit être relativement petit et stable,
- ils doivent adopter un comportement de réciprocité et de confiance (capital social).
Conclusion : un défi pour les sciences sociales
Il ressort clairement des travaux d’Ostrom que l’idée selon laquelle les appropriateurs sont bien souvent incapables de créer leurs propres institutions pour résoudre des problèmes liés aux ressources communes est largement fausse. Dans ces conditions, les chercheurs en sciences sociales doivent se défaire d’un certain nombre de préjugés portant sur les individus utilisant des ressources communes – ceux-ci seraient capables de maximisation à court terme mais pas à long terme, ils se trouveraient dans un piège dont ils ne pourraient s’extraire sans l’intervention d’une autorité extérieure, leurs institutions locales seraient inefficaces etc. L’effort doit désormais porter, non sur la création de modèles universels conçus par des observateurs omniscients capables de comprendre le fonctionnement de systèmes dynamiques complexes, mais sur la création de modèles locaux utilisables sur un terrain particulier. Comme le dit Ostrom, « chaque ressource commune peut être considérée comme une niche sur un terrain empirique ». On retrouve là l’idée désormais classique selon laquelle les sciences sociales doivent plutôt chercher à développer des théories à moyenne portée (soumises au critère de réfutabilité) que des théories générales, et qu’elles sont avant tout au service de l’action.
Les auteurs
Elinor Ostrom est une politologue américaine. Ses travaux portent principalement sur la théorie de l’action collective et des biens publics (matériels ou immatériels) et s’inscrivent dans le cadre de la « nouvelle économie institutionnelle ». En octobre 2009, elle est la première femme à recevoir le Prix Nobel d’économie, avec Oliver Williamson, « pour son analyse de la gouvernance économique et, en particulier, des biens communs.
Laurent Baechler enseigne l’introduction à la microéconomie et à la macroéconomie à Sciences-Po (Paris et Dijon), ainsi que l’économie internationale à des étudiants de Master de l’Institut Européen des Hautes Etudes Internationales (Istanbul et Nice).
Table des matières
Avant-propos
I - Réflexion sur les biens communs
Trois modèles influents
L’utilisation métaphorique des modèles
Prescriptions politiques actuelles
Un défi
II - Une approche institutionnelle de l’étude de l’auto-organisation et de l’autogouvernance dans les situations de ressources communes
La situation de ressource commune
Interdépendance, action indépendante et action collective
Trois problèmes : la mise en place, l’engagement et la surveillance
Définir le cadre de l’enquête
L’étude des institutions dans les situations de ressource commune
III - Analyse de systèmes de ressources communes durables auto-organisés
Tenure communale dans les prairies et forêts de haute montagne
Institutions des systèmes d’irrigation de huertas
Communautés d’irrigation des zanjeras aux Philippines
Similitude entre les institutions de ressources communes durables et auto-organisées
IV - Analyse des changements institutionnels
La course au pompage
Le jeu de la procédure judiciaire
Le jeu de l’entrepreneuriat
L’analyse de la mise en œuvre institutionnelle
V - Analyse des défaillances et vulnérabilités institutionnelles
Deux pêcheries littorales turques confrontées à des problèmes de ressources communes permanents
Des nappes aquifères californiennes confrontées à des problèmes de ressources communes permanents
Une pêcherie sri lankaise
Projets de développement de systèmes d’irrigation au Sri Lanka
La fragilité des pêcheries littorales de Nouvelle-Ecosse
Les leçons à tirer de la comparaison des cas présentés dans cette
étude
VI - Un cadre pour l’analyse des ressources communes auto-organisées et autogouvernées
Les problèmes de la mise en place, de l’engagement crédible et de la surveillance mutuelle
Un cadre pour l’analyse du choix constitutionnel
Un défi pour la recherche en sciences sociales
Références bibliographiques
Index
Table des matières
Quatrième de couverture
La question de la gouvernance des ressources naturelles utilisées conjointement par de nombreux individus revêt une importance croissante pour les analystes politiques. Tant la nationalisation que la privatisation ont été mises en avant, mais ni l’Etat ni le marché n’ont été uniformément en mesure de résoudre les problèmes liés aux ressources communes.
Remettant en question les fondements de l’analyse politique telle qu’appliquée aux ressources naturelles, Elinor Ostrom fournit dans cet ouvrage un ensemble unique de données empiriques afin d’étudier les conditions dans lesquelles des problèmes de ressources communes ont été résolus, de manière satisfaisante ou non.
L’auteur décrit d’abord les trois modèles les plus fréquemment utilisés en tant que fondement pour préconiser des solutions se basant sur l’Etat ou le marché. Elle passe ensuite en revue les alternatives théoriques et empiriques à ces modèles afin d’illustrer la diversité des situations possibles. Dans les chapitres suivants, elle fait appel à l’analyse institutionnelle en vue d’examiner diverses stratégies-fructueuses ou infructueuses- de gouvernance des biens communs.
Contrairement à ce qu’affirme l’argument de la « tragédie des biens communs », les problèmes de ressources communes peuvent être résolus par des organisations volontaires plus efficacement que par un Etat coercitif. Parmi les cas considérés figurent la tenure communale de prairies et de forêts, des communautés d’irrigation, des droits relatifs à l’eau ainsi que des sites de pêche.
Gouvernance des biens communs apporte une contribution majeure à la littérature analytique et à notre conception de la coopération humaine.