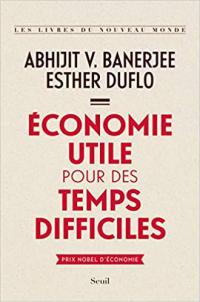
Synthèse courte
Introduction
Avec cet ouvrage, Esther Duflo et Abhijit V. Banerjee, récompensés par le prix Nobel d’économie 2019, souhaitent éclairer les grandes questions économiques de notre temps, comme l’immigration, le libre-échange, la croissance, les inégalités ou l’environnement. En tant qu’économistes du développement, ils estiment que les problèmes auxquels sont confrontés les pays pauvres, qu’ils ont longuement étudiés au cours de leurs recherches, sont en réalité très proches de ceux qui touchent les pays avancés du Nord : progression de l’exclusion sociale, inégalités galopantes, défiance envers les gouvernants, fragmentation des sociétés et fragilisation du lien social…Dès lors, le matériau empirique accumulé par les économistes, et leur regard scientifique fondé sur les faits, au-delà de certains discours simplistes et idéologiques, leur donne une certaine légitimité pour apporter leur pierre, afin de « bâtir un monde plus humain ».
A l’heure où l’on observe selon eux une « tribalisation de l’opinion », les chercheurs en sciences sociales, parmi lesquels les économistes, doivent s’impliquer à condition de ne pas eux-mêmes sombrer dans des analyses normatives trop faiblement étayées : « nous économistes de métier, sommes souvent trop enfermés dans nos modèles et nos méthodologies, et il nous arrive d’oublier où finit la science et où commence l’idéologie ».
En plaidant pour une modestie des économistes dans le débat public, Esther Duflo et Abhijit V. Banerjee soulignent que « les économistes sont plutôt des plombiers : ils résolvent les problèmes par un mélange d’intuition faite de science, de conjecture fondée sur l’expérience et d’une bonne dose d’essais et d’erreurs ».
L’ambition des auteurs est de replacer la dignité humaine au cœur de nos préoccupations, en redéfinissant radicalement les priorités économiques et les dispositifs institutionnels de protection des plus démunis.
Les économistes et l’immigration
Esther Duflo et Abhijit V. Banerjee s’attaquent à la question sensible de l’immigration, centrale dans le débat public des pays riches : si la part des migrants dans la population mondiale reste stable à 3%, au même niveau où elle se situait en 1960 et en 1990, et si l’on compte, en 2018, 1 réfugié pour 2500 habitants de l’Union européenne, guère plus, la question migratoire est attisée par des partis politiques qui en font leur cheval de bataille dans de nombreux Etats membres tentés par les préjugés et le repli sur soi. Les auteurs appellent de leurs vœux une appréhension dépassionnée de l’immigration : s’il est indéniable que beaucoup de gens sont si désespérés qu’ils sont prêts à tout quitter, le mystère est plutôt que tant d’autres ne le fassent pas quand ils en ont la possibilité. Les économistes ont relativisé depuis longtemps l’impact de l’immigration sur le marché du travail et sur les salaires des populations autochtones : en réalité les travaux les plus fiables sur le sujet montrent que les vagues migratoires des travailleurs peu qualifiés ont un impact très faible sur les rémunérations et les perspectives d’emploi de la population d’accueil. Les dépenses de consommation des immigrés soutiennent la demande de travail peu qualifié, et leur arrivée ralentit le processus de substitution du capital au travail et d’économies de main-d’œuvre. De plus, les immigrés et les travailleurs autochtones ne sont pas forcément en concurrence directe sur le marché du travail (ils occupent très souvent des tâches différentes).
Par ailleurs, les perspectives de gains et les incitations pécuniaires offertes par l’exil pour s’établir dans les pays du Nord devraient nourrir des flux migratoires beaucoup plus puissants que ceux que l’on observe aujourd’hui : « à moins qu’une catastrophe ne les oblige à partir, la plupart des pauvres préfèrent rester chez eux. Ils ne frappent pas à notre porte ; ils préfèrent de loin leur pays. Ils ne veulent même pas nécessairement migrer dans la capitale de la région où ils vivent ». Preuve en est que les pauvres des pays émergents, ancrés dans leurs communautés traditionnelles et attachés leurs liens familiaux, ne sont pas forcément des candidats à l’émigration et aux opportunités économiques existantes.
C’est un point important sur lequel Esther Duflo et Abhijit V. Banerjee insistent au fil de leur ouvrage : les économies sont « rigides », au sens où la mobilité des personnes (et des travailleurs) dans l’espace est bien loin d’atteindre celle du capital, et les personnes s’inscrivent dès lors dans des territoires qui peuvent subir des chocs macroéconomiques violents. Alors que la mobilité (interne et internationale) est un des principaux facteurs d’égalisation des niveaux de vie entre pays différents et d’absorption des disparités économiques régionales, la relative faiblesse des déplacements de population limite les possibilités d’amortir les crises et les transformations structurelles des économies. Dès lors, selon Esther Duflo et Abhijit V. Banerjee, alors que le monde est plutôt marqué par l’immobilité, il s’agirait, plutôt que de freiner les obstacles aux migrations nationales internationales, de les favoriser.
Vertus et déboires du commerce international
Les auteurs notent malicieusement que les économistes, armés des enseignements canoniques du modèle de Ricardo, de la théorie néoclassique du commerce international (le célèbre théorème « HOS ») et du théorème Stolper/Samuelson, croient nettement plus aux gains du libre-échange…que l’opinion publique. En vertu de ce dernier théorème, après spécialisation, le libre-échange devrait conduire à une égalisation des rémunérations à l’échelle internationale : l’ouverture des échanges entre les Etats-Unis et la Chine devrait donc nuire aux salaires des travailleurs américains et bénéficier aux travailleurs chinois. Mais le gain mutuel à l’échange devrait aussi permettre, comme l’a montré Samuelson, une croissance du PIB plus forte et donc une élévation des niveaux de vie, et les travailleurs américains pourront alors se porter mieux si la société taxe les gagnants du libre-échange et distribue cet argent aux perdants. Mais les décisions politiques n’ont pas forcément suivi en ce sens, jusqu’à la victoire de Donald Trump en 2016 qui a plaidé pour une vaste réorientation de la politique commerciale des Etats-Unis en faveur du protectionnisme, dans un contexte où les inégalités se sont nettement accrues (entre les travailleurs qualifiés et les travailleurs non qualifiés), et où les rémunérations au sein de la classe moyenne américaine ont stagné, voire régressé depuis les années 1970. Encore une fois, Esther Duflo et Abhijit V. Banerjee insistent, comme avec les migrations, sur la rigidité du marché du travail : « les gens ne bougent pas, même quand les conditions du marché du travail suggèrent qu’ils en tireraient bénéfice, et de ce fait les salaires ne s’égalisent pas de manière automatique. En réalité plusieurs économies coexistent à l’intérieur d’un même pays ». Dans certaines régions, les travailleurs sidérurgistes de Pennsylvanie qui perdent leur emploi en raison du « choc chinois » et à cause de la concurrence de la main-d’œuvre étrangère, ne peuvent aisément se déplacer dans le Montana ou le Missouri, et restent piégés par l’effondrement du marché du logement au niveau local, par la fermeture des commerces et des lieux de sociabilité (« la rigidité de l’économie s’est muée en piège implacable »). Les raisonnements des modèles du commerce international, qui décrivent avec élégance les gains de l’ouverture aux échanges (en réalité quantitativement assez faibles pour une grande nation productive comme les Etats-Unis), se situent au niveau agrégé de l’économie nationale, et décrivent assez peu ces chocs régionaux du commerce qui peuvent être dévastateurs. Ces chocs sont en effet concentrés sur des districts industriels et leurs populations, confrontées à des destructions d’emplois en cascade, et à un appauvrissement durable.
Rien d’étonnant dès lors à ce que ces régions soient beaucoup plus réceptives aux discours politiques critiques de la mondialisation (« les pressions intérieures pour plus de protection se font plus fortes en temps de crise, et les réglementations en matière de sécurité sont souvent utilisées comme un prétexte pour protéger les producteurs nationaux »).
Les gains et les pertes du commerce ont été distribués de façon très inégale, et, dans un cadre de mobilité internationale des marchandises, les souffrances des personnes forcées à l’immobilité dans leurs zones sinistrées, ont été sous-estimées.
La fin de la croissance ?
Esther Duflo et Abhijit V. Banerjee abordent aussi dans cet ouvrage la question clé de la croissance économique et de son ralentissement depuis 1973. Entre les prophéties pessimistes d’un Robert Gordon sur la « stagnation séculaire » et les déceptions de l’innovation et de son impact sur les gains de productivité qu’il décrit, et les analyses plus optimistes d’un Joel Mokyr sur les potentialités énormes de la révolution numérique, les auteurs rappellent la modestie dont devraient faire preuve les économistes sur cette question. Selon eux « ce que nous pouvons dire également, c’est que rien, dans les données dont nous disposons aujourd’hui, ne promet le retour d’une croissance du PIB mesuré s’approchant de celle qui a caractérisé les Trente Glorieuses en Europe et l’âge d’or aux Etats-Unis ». En rappelant les grands apports des théoriciens de la croissance économique, de Robert Solow qui insiste sur le ralentissement de la croissance quand les pays arrivent à un certain niveau de revenu par tête, à Paul Romer, pour lequel la croissance est un mécanisme qui s’auto-entretient et porté par les nouvelles idées et les inventions, ils reconnaissent que, pour l’heure, les ressorts profonds et à long terme de la croissance économique restent mystérieux (« personne ne sait si la croissance va repartir dans les pays riches, ni ce qu’il faudrait entreprendre pour la favoriser »).
Dès lors, Esther Duflo et Abhijit V. Banerjee préconisent de cibler les efforts des politiques économiques sur l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être (éducation, santé) des plus pauvres, plutôt que de multiplier les efforts pour élever légèrement le taux de croissance du PIB mesuré.
La question centrale autour de la croissance est évidemment celle de sa soutenabilité sur le long terme : un très large consensus scientifique indique que l’activité humaine est responsable du changement climatique, et que le seul moyen d’éviter la catastrophe est de réduire les émissions de carbone. Esther Duflo et Abhijit V. Banerjee évoquent la règle des 10/50 : 10% de la population mondiale (les plus gros pollueurs) contribuent environ à la moitié des émissions mondiales de CO2, et les 50% qui polluent le moins n’y contribuent qu’à un peu plus de 10%. Dès lors, « les habitants des pays riches et, plus généralement, le monde riche, ont donc une responsabilité accablante dans le changement climatique en cours et à venir ». Les auteurs ne font pas mystère qu’il n’y aura pas de « repas gratuit » : les nouvelles technologies « vertes » qui permettront de réduire la consommation énergétique ne suffiront sans doute pas, et il faudra que notre consommation individuelle diminue vraiment. Ils plaident pour qu’un alliage de réglementations et de fiscalité permettent d’infléchir les émissions dans les pays riches et de financer une transition écologique dans les pays pauvres : même si ces efforts des pays avancés pourraient freiner leur croissance économique, le fardeau pourrait être supporté, le cas échéant, par les plus riches au sein de ces pays riches.
La question centrale autour de la croissance est évidemment celle de sa soutenabilité sur le long terme : un très large consensus scientifique indique que l’activité humaine est responsable du changement climatique, et que le seul moyen d’éviter la catastrophe est de réduire les émissions de carbone. Esther Duflo et Abhijit V. Banerjee évoquent la règle des 10/50 : 10% de la population mondiale (les plus gros pollueurs) contribuent environ à la moitié des émissions mondiales de CO2, et les 50% qui polluent le moins n’y contribuent qu’à un peu plus de 10%. Dès lors, « les habitants des pays riches et, plus généralement, le monde riche, ont donc une responsabilité accablante dans le changement climatique en cours et à venir ». Les auteurs ne font pas mystère qu’il n’y aura pas de « repas gratuit » : les nouvelles technologies « vertes » qui permettront de réduire la consommation énergétique ne suffiront sans doute pas, et il faudra que notre consommation individuelle diminue vraiment. Ils plaident pour qu’un alliage de réglementations et de fiscalité permettent d’infléchir les émissions dans les pays riches et de financer une transition écologique dans les pays pauvres : même si ces efforts des pays avancés pourraient freiner leur croissance économique, le fardeau pourrait être supporté, le cas échéant, par les plus riches au sein de ces pays riches. Esther Duflo et Abhijit V. Banerjee insistent en effet sur un trait marquant de nos sociétés : le creusement des inégalités. La mondialisation et l’essor du secteur des nouvelles technologies de l’information, combinés à une économie rigide et à d’autres changements structurels, au niveau local, ont accru les écarts de performance entre les entreprises et les écarts de rémunération entre les travailleurs. En critiquant la thèse du « ruissellement », ils estiment que la fiscalité peut être un outil efficace pour réduire les inégalités économiques les plus criantes : « tout bien considéré donc, il nous semble que les taux marginaux élevés d’imposition, quand ils ne s’appliquent qu’aux très hauts revenus, sont un moyen tout à fait raisonnable de limiter l’explosion des inégalités au sommet de l’échelle des revenus ».
Pour les auteurs, il n’existe pas en économie de loi d’airain qui nous empêcherait de construire un monde plus humain : la science économique n’assène pas de vérités dogmatiques. Ils appellent de leurs vœux une politique sociale « qui aide les gens à retrouver leur dignité dans un monde d’inégalités très fortes », afin de renforcer la confiance des citoyens dans la capacité de la société et des gouvernements à donner de nouvelles opportunités à ceux qui ont les plus faibles ressources. Mais selon eux, confisquer les revenus des 1% les plus riches ne peut être l’alpha et l’oméga de la politique sociale : il s’agit surtout d’améliorer les conditions de vie des 99% restants, par un « keynésianisme intelligent » à même de « subventionner le bien commun ». L’intervention de l’Etat, en complément de marchés qui ne sont pas naturellement justes et efficaces, doit favoriser la mobilité des individus, pour les aider à absorber les chocs qui les frappent sur leurs territoires, leur offrir une mobilité sociale intergénérationnelle par la réduction des inégalités en matière d’éducation et de capital humain, afin d’ouvrir le champ des possibles et multiplier les opportunités de mener une vie bonne.
Quatrième de couverture
« Nous avons écrit ce livre pour garder espoir. Pour parler de ce qui ne s'est pas bien passé, et raconter pourquoi, mais aussi de tout ce qui est allé dans le bon sens. » Esther Duflo et Abhijit V. Banerjee
Face aux inégalités qui explosent, aux désastres politiques et aux catastrophes environnementales qui menacent de toutes parts, cet ouvrage montre que tout n'est pas perdu. Si des choix de politiques publiques nous ont menés où nous sommes, rien n'empêche d'en faire d'autres. À condition de dresser, d'abord, un constat honnête. Ces pages traquent les fausses évidences sur toutes les questions les plus pressantes : immigration, libre-échange, croissance, inégalités, changement climatique. Elles montrent où et quand les économistes ont échoué, aveuglés par l'idéologie.
Mais l'ouvrage ne fait pas que renverser les idées reçues. Il répond à l'urgence de temps troublés en offrant un panel d'alternatives aux politiques actuelles. Une bonne science économique peut faire beaucoup. Appuyée sur les dernières avancées de la recherche, sur des expériences et des données fiables, elle est un levier pour bâtir un monde plus juste et plus humain.
En cela, Économie utile pour des temps difficiles est aussi un appel à action.
Les auteurs
Esther Duflo et Abhijit V. Banerjee sont lauréats du prix Nobel 2019. Esther Duflo est la plus jeune économiste jamais récompensée par le prix Nobel. De réputation internationale, ces deux chercheurs sont professeurs d'économie au MIT (Massachetts Institute of Technology). Ils y ont cofondé en 2013 et y co-dirigent le J-PAL, laboratoire d'action contre la pauvreté.
Ils ont signé, en 2012, Repenser la pauvreté (Seuil), traduit en 17 langues.



